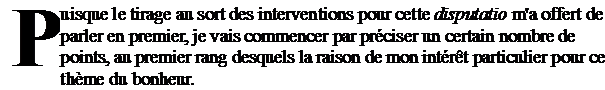Entrée sur site http://bien.vieillir.perso.neuf.fr/
en octobre 2015
QUI NOUS FERA VOIR LE BONHEUR ?
Christophe ANDRÉ et Martin STEFFENS,
Éditions Le Passeur, 2014.
Introduction
Nous avons déjà publié plusieurs articles issus des œuvres
de Christophe André :
André Christophe, Vivre
heureux. Psychologie du bonheur (ouvrage, 2003)
André Christophe et Françoise Lelord, L’estime
de soi, s’aimer. Pour mieux vivre avec les autres (
ouvrage,1999)
André Christophe, Les états d’âme :
Un apprentissage de la sérénité.
Régulation des états d’âme. La vie
en pleine conscience ( ouvrage, 2009)
André
Christophe , Thomas d’Ansembourg,
Isabelle Filliozat, Eric Lambin, Jacques Leconte, Mathieu Ricard, sous la
coordination de Ilios Kotsou et de Caroline Lesire ( ouvrage, 2011)
Psychologie positive : le bonheur dans
tous ses états.
Cet article-ci est
une reproduction des pages 17 – 27 et 32 – 35 de l'ouvrage cité en titre, la
contribution est de Christophe André.
°°°°°°
|
Page 17 à 27
Pourquoi le
bonheur ? Il s'agit,
avant tout et évidemment, d'un intérêt d'être humain : comme l'ont
depuis longtemps noté les philosophes, tous les humains sont concernés par le
bonheur, tous les hommes aspirent à être heureux, aussi heureux que possible.
Car mon
intérêt pour le bonheur est aussi un intérêt professionnel. Au début, Psychiatrie et
psychologie positive Mais peut-être
vous semble-t-il bizarre que je vous parle, lors d'un débat consacré au
bonheur, de la souffrance et de la maladie ? Pourtant, il me semble que
c'est bien comme cela que ça se passe dans nos vies. La nécessité du bonheur
n'est jamais aussi vive, n'est jamais aussi forte que lorsqu'on souffre,
lorsqu'on a souffert ou lorsqu'on voit d'autres personnes souffrir. Quand on
est soignant, on n'a guère envie d'ironiser sur le bonheur, ou de le
dévaloriser : nos patients en manquent trop, ou en ont trop besoin. Et
nous sentons bien qu'il nous est nécessaire d'être heureux pour bien soigner
sans nous épuiser, sans nous user, sans nous abîmer : c'est le bonheur
qui donne aux soignants la force de la compassion. Sans lui, face aux
souffrances de nos patients, notre empathie s'émousserait et nous ferait
souffrir. Pour en
revenir à ce que je vous disais à l'instant, nous avons donc, nous les
psychiatres, modifié notre discours adressé aux patients fragiles. Ce n'est
plus « oubliez et n'y pensez plus », mais « vivez
différemment, prenez le temps de réfléchir pour voir comment rendre votre vie
plus heureuse, comment considérer de manière plus sérieuse tout ce qui peut
vous donner un peu plus de bonheur ». Le bonheur, ou du moins davantage
de bonheur, comme outil de prévention, Aussi
sommes-nous de plus en plus nombreux ‒ psychologues,
psychothérapeutes, psychiatres ‒ à nous être
engagés dans un mouvement de réflexion qui parcourt nos disciplines depuis de
longues années maintenant(1). Les études
conduites sur ce qui influence notre bien-être montrent le plus souvent que
nos aptitudes au bonheur dépendent de divers facteurs, dont certains ne sont
plus à notre portée car ils sont, par exemple, d'ordre génétique. Il y a, en
matière d'aptitude au bonheur, les mêmes inégalités que dans tous les autres
domaines composant un être humain (mais ces inégalités de départ sont
heureusement largement rattrapables). D'autres influences tiennent à notre
passé, à ce qu'il a été, Les surdoués
du bonheur En effet, il y
a des gens doués pour le bonheur, il y a même des surdoués ! Mon beau-père
habite au Pays basque, avec ma belle-mère, dans une grande maison assez
isolée au cœur de la campagne, face aux montagnes. Il y a quelques années, ma
belle-mère était partie en pèlerinage, je ne sais où en Italie, elle l'avait
laissé seul pendant une semaine. En se déplaçant pour aller dans son jardin, Et lorsqu'on
n'est pas un surdoué du bonheur ? Malheureusement,
nous ne sommes pas tous aussi bien lotis ! Nous ne sommes pas tous des
surdoués du bonheur. Moi le premier, et la plupart des gens que j'ai à
soigner, et beaucoup de personnes avec qui j'ai à soigner, et beaucoup de
personnes avec qui j'en parle. Ainsi donc, depuis pas mal d'années
maintenant, nous réfléchissons à ce qu'on appelle la psychologie positive.
Pourquoi « positive » ? C'est pour
cela que mon intervention et mon débat avec Martin Steffens vont être marqués
par cette position de médecin. Ce qui m'intéresse dans le bonheur est bien
sûr sa nature, dont nous allons parler, mais c'est surtout la possibilité
d'apprendre, Une définition
du bonheur en forme d'équation La manière
dont on aborde la question du bonheur dépend aussi beaucoup de la définition
qu'on en donne. J'ignore quelle définition
Martin Steffens va utiliser pour nous parler du bonheur, mais je vais
vous proposer la mienne, qui est la définition que je donne à mes patients,
je l'aime beaucoup parce qu'il me semble qu'elle est simple, juste et
pédagogique ; et vous avez compris que tout ce qui est pédagogie et en
enseignement du bonheur me tient énormément à cœur. De mon point de vue et du
point de vue d'un certain nombre de mes collègues, le bonheur pourrait se
résumer à une sorte d'équation mathématique selon laquelle le bonheur, c'est
du bien-être plus de la conscience. Si j'avais un tableau noir,
j'écrirais : Bonheur
= bien-être + conscience Ce
qu'on appelle le bien-être est une donnée animale : tous les animaux
ressentent le bien-être. On ressent du bien-être lorsqu'on a le ventre plein,
lorsqu'on mange de bonnes choses, lorsqu'on est dans des environnements où on
se sent en sécurité, où il fait beau, où il n'y a pas de prédateurs, où il y
a de la nourriture et des ressources.
On ressent du bien-être quand on est avec des congénères pacifiques,
bienveillants, aidants, etc. Donc les cochons, les moutons, les dindons
ressentent du bien-être, et les humains aussi. Par exemple, si vous êtes en
train de manger un bon plat, avec quelqu'un que vous aimez bien, dans un
endroit agréable, c'est du bien-être. C'est déjà très bien que cela survienne
dans nos vies, en tout cas, c'est mieux que du mal-être : mieux que
manger des aliments insipides, avec quelqu'un qu'on n’aime pas, dans un
endroit laid. Mais
ce n'est que du bien-être. Les humains peuvent faire mieux, ressentir
quelque chose de plus fort. Nous parlons alors de bonheur :
bonheur lorsque, dans notre bien-être, quelque chose de différent se passe,
lorsque, tout à coup, nous prenons conscience de la beauté, de la douceur, de
l'harmonie, de la sérénité, bref, de toutes les grâces contenues dans cet
instant. Lorsque tout à coup, nous réalisons que c’est une chance de manger
ce que nous mangeons, que c’est une chance d’être avec cette personne, que
c’est une chance d’être dans cet endroit, que c’est une chance finalement
d’être en vie et de pouvoir tout simplement savourer cet instant. À ce moment
là, lorsque nous prenons conscience de cette chance ou de cette grâce, le
sentiment de bien-être, qui, encore
une fois, est un sentiment agréable dont je ne conteste pas l'utilité ni la
nécessité, le sentiment de bien-être
donc se transforme, Bonheur
et mémoire du bonheur
Pour
en rester aux simples aspects psychologiques ‒ nous
parlerons peut-être d'autres dimensions tout à l'heure ‒, ce sentiment de bonheur va, par exemple,
s'inscrire dans ma mémoire beaucoup plus fortement qu'un simple sentiment de
bien-être. Si je mange quelque chose de bon avec un ami, mais que mon esprit
n'est pas conscient de ce qui m'arrive, que je suis en train de penser à mon
travail, à des soucis, à l'endroit où j'ai garé ma voiture, cela reste du
bien-être, mais cet instant sera vite oublié, effacé de ma vie. Si, en
revanche, j'ouvre les yeux de mon esprit, Et
il y a aussi de fortes chances que je le mémorise d'une façon beaucoup plus
nette et qu'il soit beaucoup plus accessible ensuite, lorsque j'aurai besoin
justement... Fin de la page 27
Page 32
Car
cette « habituation hédonique » représente un problème constant par
rapport à ce qu'on appelle le bonheur, c'est-à-dire cette capacité à extraire
du quotidien des instants de conscience portés sur tout ce qui va bien dans
nos existences. Petits, tout-petits
bonheurs ? D'abord, en
tant que médecin, en tant que thérapeute, je n'ai pas à parler à mes patients
de choses trop difficiles à atteindre, de choses trop compliquées à
comprendre : ce sont souvent des personnes fragiles, « cabossées de
la vie » comme on dit, et je ne veux pas les mettre en échec avec des objectifs
de bonheur trop ambitieux. Donc je travaille avec des choses très, très
simples, je les accompagne sur un chemin facile et accessible, au moins au
début. Car, pour la suite, j'ai tout de même une idée derrière la tête et des
ambitions pour eux (dont je ne leur parle pas trop vite pour ne pas leur
mettre la pression). Car cette
formule : Bonheur
= bien-être + conscience peut se décliner à l'infini, et nous
emmener très loin et très haut. Si ce qui nous apporte du bien-être ce sont
des actions potentiellement chargées de sens, comme rendre service à
quelqu'un ou être aidé par un proche, le fait de prendre conscience de ces
actions pleines de sens va me rendre profondément heureux. Nous avons, Parmi ces
bonnes choses de la vie que nous devons aux autres, il y a bien sûr tous les
sourires, toutes les paroles gentilles, tous les gestes d'aide, tout ce qui
est dirigé volontairement vers nous : c'est assez facile à identifier.
Mais il y a aussi tout le reste : si vous écoutez une musique agréable à
la radio ou sur un disque, vous avez l'impression qu'il s'agit d'un plaisir
qui ne concerne que vous ; c'est vous qui avez allumé l'appareil, c'est
vous qui avez lancé la musique ; mais en réalité, cette musique a été
imaginée, composée, interprétée par d'autres humains. Lorsque vous prenez
votre douche le matin et que vous faites l'exercice de vous dire :
« J'ai de la chance de ne pas être un cochon, un dindon, une araignée
mais plutôt un humain, car j'appartiens à une espèce qui a inventé l'eau
chaude à volonté, les canalisations, les chauffe-eaux... » ;
lorsque vous prenez votre douche et que vous vous apercevez que tout ce que
vous vivez à cet instant est dû à une multitude d'intelligences et d'aides
humaines, même si elles n'étaient pas directement centrées sur vous, eh bien
vous faites un exercice de gratitude ! On a pu montrer que lorsque je
savoure quelque chose en prenant conscience que je le dois à d'autres, ça me
fait encore plus de bien que si je le savoure dans mon petit monde clos, dans
une illusion d'autarcie. Chaque fois que je prends conscience que la
quasi-totalité de ce qui m'arrive de bon est dû à d'autres personnes, alors
mon bien-être est encore plus grand, mon bonheur est encore plus fort. La
gratitude est un sentiment de dette joyeuse : elle m'aide à voir tous
ces liens humains, connus ou inconnus, qui embellissent ma vie, elle m'aide à
comprendre que, sans les autres, mon existence serait bien triste et
insipide. Ce fruit que je mange et savoure ‒
bonheur ! ‒ a été planté,
jardiné, cueilli et amené jusqu'à moi par d'autres ; sans eux, je ne le
savourerais pas à cet instant ‒ double
bonheur ! Lorsqu'on est
croyant, on peut bien évidemment élargir encore plus ce sentiment de
gratitude ou l'élever encore plus : ma gratitude porte non plus
seulement sur mes semblables mais sur le Dieu aimant et bienveillant qui m'a
créé et qui veille sur moi. Cette pensée peut alors me rendre profondément et
tranquillement heureux. Voilà donc
pourquoi cette équation simpliste : Bonheur = bien-être + conscience
est tout pour
moi sauf simpliste, justement ! Elle est simple, ce qui n'est pas la
même chose. Voilà aussi pourquoi, en psychologie positive, nous pouvons décliner
à partir d'elle tout un ensemble d'interventions, tout un ensemble
d'exercices ‒ puisque nous
appelons cela des exercices ‒ que nous
proposons à nos patients. Il y a
beaucoup, beaucoup d'autres choses à dire, vous vous en doutez. Mais ce qui
nous réunit ce soir, c'est une disputatio,
ce n'est pas un monologue. Je vais donc maintenant goûter au bonheur de
me taire et de me reposer, et surtout à celui d'écouter Martin Steffens. Fin de la page 35
1.
Jacques Lecomte (sous la dir. de), Introduction à la psychologie positive,
Dunod, 2009. 2.
Jules Renard, Journal, 21 septembre 1894, Robert Laffont (coll.
« Bouquins »), 1990, |