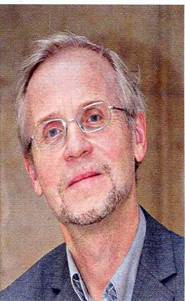Sections du site en Octobre 2009 : Ajouts successifs d’articles -- Sujets d’articles à traiter – Pour publier -- Post-Polio -- L'aide à domicile -- Internet et Handicap -- Informatique jusqu’à 100 ans – Etre en lien -- L’animal de compagnie -- Histoires de vie -- Donner sens à sa vie – A 85 ans aller de l’avant -- Tous chercheurs -- Liens –Le webmestre.
RETOUR A LA PAGE D’ACCUEIL : CLIC AUTEURS, TITRES
DE TOUS ARTICLES : CLIC SYNTHESE GENERALE: CLIC
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Juillet
2015
COMMENT DIEU EST DEVENU DIEU
EXTRAIT DU MONDE DES RELIGIONS (2015)
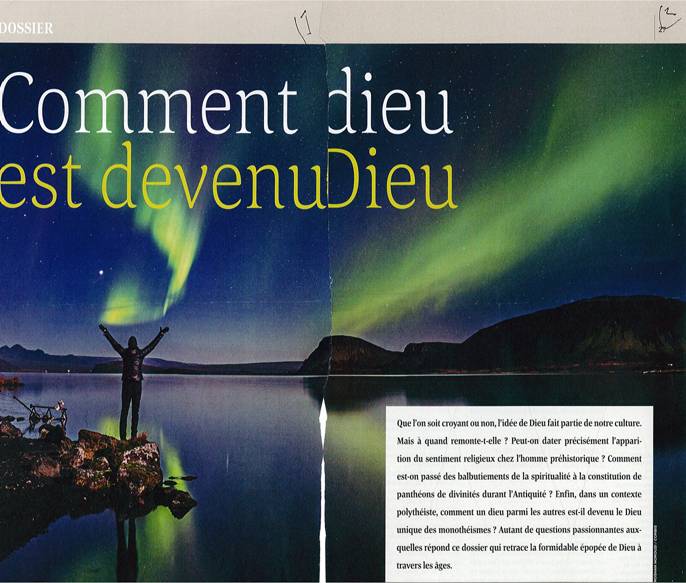
Note : On pourra consulter
sur ce site des précédents articles
extraits du Monde des religions :
Le Monde des Religions (2010), La vie après la mort. Ce que les religions nous disent de l’au-delà
Le Monde des Rreligions (2010), Dieu et la science. Des scientifiques prônent un nouveau dialogue entre science et spiritualité
Le Monde des Religions
(2010), La naissance des Dieux. Quand les Dieux étaient des déesses. La naissance du monothéisme
°°°°°
À L’AUBE DE LA SPIRITUALITÉ
DES PROFONDEURS
VINT UNE LUEUR
En
traquant les croyances des populations préhistoriques à partir de vestiges,
d’objets symboliques ou de représentations iconographiques, les archéologues
ont esquissé l’émergence progressive, au fil des millénaires, d’une pensée
tournée vers la spiritualité. Avant
l’apparition des dieux. Par Hélène Bourg
HÉLÈNE
BOURG est préhistorienne, responsable
de l’Espace de l’Homme de Spy (Onoz,
Belgique). Ce centre d’interprétation présente une scénographie autour de la
grotte de Spy, haut lieu de l’archéologie
néandertalienne.
L
|
Le processus
d’hominisation – qui a vu l’évolution des primates en humains – s’est déroulé sur des millions d’années. Des hominidés se
redressent, deviennent bipèdes, défient les lois biologiques en utilisant et
fabriquant des outils, témoignent d’une organisation sociale sophistiquée,
s’étendent sur des territoires de plus en plus lointains, découvrent et
s’adaptent à des milieux variés, complexifient leurs systèmes techniques, les
transmettent à d’autres groupes, et redoublent encore d’audace en maîtrisant,
puis en domestiquant, le feu… De notre XXIe siècle, nous observons
ces enchaînements, à la fois biologiques et culturels, et guettons cet instant
où l'on pourra affirmer que l'hominidé est devenu Homme. Ou encore : que
cet homme est pétri de spiritualité. Mais les critères de cette humanité
restent flous, les traces fugaces et les préjugés idéologiques tenaces. Si
certains voient dans cette succession d'étapes une formation progressive de
l'Esprit, d'autres affirment que c'est cet Esprit même qui a été le moteur de
toute l'évolution.
|
La puissance évocatrice des parois ornées des grottes
suggère bien plus qu’une simple recherche esthétique. Grotte des mains. Santa Cruz (Argentine).
Période néolithique. |
UNE ATTENTION ACCORDÉE AU DÉFUNT
Plutôt que chercher d'emblée des traces de préoccupations
« spirituelles », avec tous les préjugés que cela sous-entend, les
préhistoriens sont donc amenés à privilégier d'abord, en toute objectivité, des
préoccupations dépassant les strictes nécessités liées à la vie quotidienne.
À partir de
l'Homo erectus (1,5 million – 300 000 ans avant le présent), des traces
troublantes commencent à être manifestes tels des colorants, des traits gravés
sur des os, des cupules* ou quelques ébauches de figurines… jusqu'à cette
accumulation étonnante, et encore discutée, d'une trentaine de squelettes
humains (datés de 500 000 ans environ) au fond d'un puits naturel sur le site
de la Sima de Los Huesos, à Atapuerca
(Espagne). Mais l'émergence de la spiritualité, qui passe notamment par une
prise de conscience de la mort, semble plus récente et ne présente des signes
irréfutables qu'après 150 000 ans.
Avec l'Homme
de Neandertal et l'Homme moderne, en Europe et en Proche-Orient, les exemples
d'inhumations se multiplient. Ainsi, les sites de Skhul
et Qafzeh en Israël (entre 130 000 et 100 000 ans), Regourdou et Roc de Marsal en
France (70 000 ans)… L'intention de protéger le défunt et de maintenir son intégrité
est alors manifeste, et une série de gestes cérémoniels précédant l'inhumation
se devine. Toutefois, aucune norme ne peut être mise en évidence, si ce n'est
la proximité des sépultures avec le lieu de la vie. Ni la nature du site, ni la
disposition, l'orientation et le recouvrement des corps, ni le mobilier
funéraire ne permettent d’isoler des constances et, à fortiori,
d'authentifier une pratique généralisée et une croyance commune en un éventuel
au-delà.
Ce n'est que beaucoup plus tard, au Paléolithique supérieur, à l'époque
du Gravettien* (30 000-22 000 avant le présent), que des changements
significatifs se produisent. L'ocre rouge devient omniprésent dans les
sépultures et les dépôts funéraires se multiplient, offrant une grande variété :
quartiers de viande, objets travaillés, coquillages perforés, éléments de
parure sont autant d'éléments qui rendent compte d'un langage symbolique de
plus en plus complexe, une diversification des usages établis à l'égard des
morts, voire de nouvelles préoccupations spirituelles. Le rôle éminemment
social de telles pratiques n'en est, lui, que plus marqué.
|
|
Avec l’Homme moderne, des gestes cérémoniels précédant
l’inhumation se devinent. Site de Qafzeh, Nazareth (Israël). Entre 130 000 et 100 000 ans. |
DE LA SPIRITUALITÉ À LA RELIGION ?
Ainsi se détache une nouvelle
conscience : la pensée de l'Homme ne se limite plus aux nécessités
matérielles quotidiennes exigées par la quête de nourriture, la reproduction et
la survie. Une distanciation s'est manifestée. Avec la prise de conscience de
la mort, l'Homme s'interroge-t-il sur le monde qui l'entoure et sur la place
qu'il y occupe ? Recherche-t-il une réalité autre que celle que ses sens
lui font percevoir et à laquelle il a toujours réagi instinctivement ?
Une religion permettant d'organiser cette
spiritualité naissante lui est-elle directement liée ? Dès que le sens du
monde a été établi, des règles de conduite sont certainement apparues pour
maintenir l'identité et l'unité du groupe, pour s'assurer de meilleures chances
de survie, aussi.
À partir de
35 000 ans environ, l'art pariétal − figurant sur les parois des grottes du
Paléolithique supérieur, attribué aux Hommes modernes, nous offre les premières
bribes d'une représentation symbolique du monde. Plus de 90 % des
représentations sont consacrées à la faune de l'époque, consommée ou non :
chevaux, bisons, mammouths, bouquetins, aurochs, ours, félins, oiseaux,
poissons et pingouins ornent les parois des grottes profondes, avec des détails
d'une minutie remarquable. Par comparaison, les quelques rares représentations
humaines, souvent hybrides (mi-homme, mi-animal), et somme toute assez
sommaires, tranchent par leur facture et leur isolement. On en trouve un bel
exemple au Puits de Lascaux, avec une scène probablement peinte vers − 17 000 et qui présente un homme à la tête
d'oiseau (peut-être s'agit-il d'un masque), mis à terre par un bison. De
nombreuses empreintes de mains et signes divers tels les vulves,
les claviformes (formes de massue) et autres figures
géométriques complètent l'ensemble.
Serait-ce des détails de mythes ou d'histoires sacrées que des
générations d'artistes nous auraient légués ? Si le paysage est absent et
la mise en scène inexistante, l'essentiel semble en tout cas posé, avec des
formes qui offrent un surcroît de réalité et de permanence. La nature sauvage y
est omniprésente et omnipotente. Les chasseurs-cueilleurs qui lui sont inféodés
ne pouvaient mieux illustrer leur rapport de dépendance, de respect, voire de
crainte à son égard.
DANS LA PÉNOMBRE DES GROTTES ORNÉES
Expliquer cet art par une simple recherche esthétique ou des pratiques
magiques censées favoriser la fécondité et la chasse, comme cela a été jadis
proposé, ne peut par conséquent que réduire sa puissance évocatrice.
La profondeur
souterraine de ces grottes ne pouvait que renforcer la relation mystique
entretenue avec les thèmes choisis, les compositions monumentales, les réduits
ornés, la résonance sonore et les signes ponctuant le parcours. Chacun de ces
éléments a dû participer à la sacralité de cet art, de même que les reliefs et
accidents naturels des parois qui sont exploités et semblent « appeler les
figures ». Mais si tout tend à faire de ces grottes des lieux privilégiés,
il est plus hasardeux d'y voir des sanctuaires dans l'antre desquels étaient
organisées des cérémonies et, encore davantage, des lieux où des hommes
providentiels communiquaient avec les forces naturelles. De cette théorie
chamanique, on préfèrera celle, plus réservée, de l'existence d'un monde invisible
et mystérieux, où auraient pu se jouer des influences, bonnes ou mauvaises.
UN
DIEU UNIQUE
LE REJET D'UN
CIEL TROP
PLEIN
Le
monothéisme est né dans un monde où régnait une pléthore de divinités. Comment
un dieu parmi les autres est-il devenu le Dieu unique ? Réponse avec
Thomas Römer, qui retrace pour nous cette formidable épopée au terme de
laquelle Yahvé, petit dieu tribal, s'est muté En Dieu universel. Propos
recueillis par Virginie Larousse
|
|
Professeur au Collège de France,THOMAS RÖMER est également professeur titulaire de Bible hébraïque à la Faculté de théologie et de sciences des religions de l’université de Lausanne (Suisse). Il est notamment l’auteur de La Bible, quelles histoires ! (Bayard, 2014) et de L’Invention du monothéisme (Seuil, 2014). |
|
|
La naissance du
monothéisme est le résultat d'un processus long et complexe. Pouvez-vous nous
en donner les principales étapes ?
● Le monothéisme tel que nous le concevons, avec un
Dieu unique qui était originellement celui d'Israël, est né tardivement, vers
les VIe-Ve siècles avant notre ère, au sein du peuple
hébreu. Cette évolution religieuse s'inscrit dans un contexte historique
particulier : en 587 avant notre ère, le temple de Jérusalem est détruit
par les troupes du roi babylonien Nabuchodonosor II. Certains Judéens* se
trouvent en exil à Babylone, d'autres en Égypte, d'autres encore sont restés au
pays. Il y a donc une grande dispersion territoriale, et on a pu se dire que le
dieu d'Israël risquait de disparaître, tout comme la royauté de ce pays avait
été anéantie. Mais curieusement, c'est de ce désastre que va jaillir l'idée
monothéiste. En effet, les scribes exilés à Babylone vont réécrire l'histoire.
Non, disent-ils, le peuple d'Israël n'a pas été anéanti par les armées des
conquérants. C'est Yahvé lui-même qui a fait venir les Babyloniens en Judée —
et qui les a donc instrumentalisés — pour sanctionner son peuple et surtout ses
rois, lesquels n'ont pas respecté la vénération exclusive qui lui était due.
Car juste
avant ces événements tragiques, sous le règne du roi Josias, vers 620 avant
notre ère, on était passé du polythéisme à la monolâtrie : tout en
admettant l'existence d'autres dieux que Yahvé, seule la vénération de ce
dernier était jugée légitime. Il faut bien garder à l'esprit que de nombreux
textes de la Bible ne nient pas l'existence d'autres dieux, comme le montre le
Deutéronome (6, 14-15) : « Vous n'irez pas à la suite d'autres
dieux, dieux des peuples qui seront autour de vous, car Yahvé, ton Seigneur, au
milieu de toi,est un Dieu
jaloux. » Yahvé devient alors le dieu Un, avant de devenir le Dieu
unique, et le temple de Jérusalem est nettoyé des symboles d'autres divinités
qui s'y trouvaient.
Par conséquent,
lorsque l'exil et la destruction de Jérusalem se produisent, les scribes
défendent l'idée qu'il s'agit d'une punition divine. Si Yahvé est capable
d'infliger cette punition, d'utiliser les Babyloniens pour châtier son peuple,
c'est qu'il est plus fort que les dieux des voisins. Des textes, par exemple
dans la deuxième partie du livre d'Ésaïe (Deutero-Ésaïe*), se moquent
d'eux : les divinités babyloniennes ne sont que des dieux faits de main
d'homme, qui ne peuvent ni parler ni interférer dans le cours des événements,
qui se brisent lorsqu'on les renverse, alors que Yahvé, lui, est un dieu
invisible, transcendant, que l'on ne peut représenter. Peu à peu s'impose
l'idée, pour les Israélites, que les dieux des autres nations sont de faux
dieux, puisque Yahvé les surpasse en puissance : « Ils sacrifiaent à des démons qui ne sont pas Dieu »,
indique le Deutéronome (32,17). C'est par là que la pensée a basculé vers le
monothéisme : les autres dieux ne sont pas de vrais dieux mais des
imposteurs, tandis que Yahvé est incomparable et, en ce sens, unique. Ce
monothéisme devient en quelque sorte l'origine même du judaïsme — avant, on ne
peut parler de judaïsme mais de religion israélite ou judéenne.
Le monothéisme est donc
né en réaction à une catastrophe. Tout comme le christianisme, d'ailleurs, qui
s'est constitué en réaction à la mort incompréhensible de Jésus : de cette
mort, on fait une victoire, avec la résurrection.
Vous parlez « d'invention de
Dieu ». Est-ce à dire qu'il s'agit de toutes pièces d'une construction
humaine ?
● C'est
une grande question philosophique à laquelle je ne saurai répondre !
Lorsque je parle d'invention de Dieu, ce n'est pas pour sous-entendre qu'un
groupe de scribes s'est réuni un jour à Babylone pour décréter, subitement, que
Dieu existe : les dieux existaient déjà partout. Il faut l'entendre comme
l'invention du monothéisme, le rejet
d'un ciel trop plein. On se rend bien compte que les dieux des polythéismes
sont des inventions humaines, mais que derrière ces images se cache peut-être une réalité que l'homme ne peut saisir
réellement, et dont il essaie de s'approcher avec toutes sortes de rites, de
mythes, d'histoires. Le fait que l'humanité, dès la Préhistoire, manifeste des
aspirations spirituelles prouve que cette quête du transcendant fait partie de
l'être humain. Il est donc plus pertinent de se demander si l'homme peut être
libéré, ou non, de toute quête spirituelle. Au moment où d'aucuns ont
prophétisé la disparition prochaine de la religion, une sorte de nouvelle
religion est apparue : l'idéologie communiste. Les discours du Parti
communiste français, même dans les années 1980, ont des accents
religieux : si l'on doute, on est excommunié. Mais cette idéologie s'est
effondrée, et la quête spirituelle a resurgi, peut-être de manière plus
individuelle aujourd'hui. Je pense que la question
spirituelle faitie de la condition humaine. C'est
peut-être cela qui distingue, par dessus tout, l'homme de l'animal. ▌
|
« Je
ne sais pas si un Monothéisme
pur est vraiment
concevable pour
l'esprit humain. » |
DIEU EST MORT, VIVE DIEU !
LE NOUVEAU
DÉSORDRE
RELIGIEUX
Sursaut des fondamentalismes, offre spirituelle en pleine expansion et
essor de l'athéisme... : l'Homo religiosus post-moderne impulse une recomposition du sentiment
religieux qui hésite entre mélange et exclusion. Dieu se porte bien,
merci. Par Mélanie Déchalotte
|
E |
En mai 68 à Paris, un
anonyme a inscrit sur un mur : « Dieu est mort. Signé :
Nietzsche. » À la célèbre formule du philosophe, une main spirituelle
s'est plu à ajouter ce correctif : « Nietzsche est mort.
Signé : Dieu. » L'annonce de la mort de Dieu était très
prématurée. Pourtant, dès le XIXe siècle, les penseurs s'accordaient
sur le « désenchantement du monde », pour reprendre les mots
du sociologue allemand Max Weber : la triade raison, science et progrès
devait se substituer à la Sainte Trinité.Le XXe
siècle semble dans un premier temps donner raison à ceux qui prophétisaient la
mort de Dieu : désaffection des églises et des vocations, laïcisation
progressive des États ― au moins en Occident. La théorie de la « sécularisation* »
fait florès auprès des spécialistes. Les mêmes qui, quelques décennies plus
tard, feront amende honorable face à la flambée mondiale de religiosité* :
réveil de l'islam et de l'évangélisme, résurgence des religions en Chine et
apparition de nouveaux mouvements religieux jusqu'en Europe. Dès les années
1970, le sociologue autrichien Peter Berger avoue que « le monde
d'aujourd'hui est aussi furieusement religieux qu'il a toujours été ; il
l'est même davantage dans certains endroits ». Au contact de la
modernité, la religion a développé simultanément plusieurs phénomènes :
déclin, renouveau (adaptation, réinterprétation), innovation, ou encore
conservatisme. Les résultats des enquêtes Valeurs des Français ―
réalisées par l'ARVAL (Association pour la recherche sur les systèmes de
valeurs) ― pointent ce paradoxe de la modernité : dans les sociétés
sorties de la religion, la religiosité prend de l'ampleur. En 2008, 50 %
des Français interrogés considèrent appartenir à une religion (74% vingt ans
avant). Mais si l'appartenance continue son recul, les croyances religieuses
augmentent : 41 % des Français déclarent croire au péché (contre
37 % en 1999) et ils sont 21 % et 35 % à déclarer croire
respectivement à l'Enfer et au Paradis (contre 18 % et 28 % en 1999).
|
Le « pélerin » butine de
croyance en croyance et pioche dans les différents systèmes des religions traditionnelles afin de se fabriquer une religion « à la carte ». |
LA RÉVOLUTION DES SYMBOLES
Du XIIIe au IIIe millénaire avant notre ère, le
Proche et le Moyen-Orient ont connu des évolutions représentant une mutation
décisive du destin de l'humanité, à commencer par un changement du mode de vie,
suivi par un bouleversement dans le mode d'acquisition alimentaire : de
chasseur-cueilleurs nomade, l'homme devient agriculteur-éleveur sédentaire.
Avec ces nouvelles manières de vivre, de penser et d'agir, les causes et
effets s'enchaînent. Sans surprise, ce que nous percevons des croyances révèle
cette nouvelle victoire face à la Nature : dorénavant au centre de
l'univers, l'Homme donne son image aux forces supérieures. C'est alors
l'apparition des dieux... ou des déesses, des taureaux associés, des ancêtres
vénérés, des rituels culturels avec prières, sacrifices et dons d'offrandes,
ainsi que des premiers espaces consacrés aux rituels. S'ouvre alors un nouveau
chapitre − un nouveau défi − de l'histoire de l'humanité : celui
d'organiser la pensée spirituelle en une pensée religieuse à proprement
parler. ▌
|
?
LEXIQUE |
|
|
Cupule En archéologie, une cupule est une cavité en forme
de petite coupe effectuée par un être humain à la
surface d'une dalle ou d'un rocher. Le rôle de ces
décorations n'est pas connu, ni l'usage exact qui en était fait. Gravettien Période du Paléolithique supérieur qui doit son nom au site de La Gravette, sur la commune de Bayac en Dordogne. L'art gravettien se caractérise par ses « Vénus » présentant souvent des formes
très généreuses. |
|
|
Naissance
des divinités, naissance de l'agriculture. La
révolution des symboles au Néolithique Jacques Cauvin (CNRS
Éditions, coll. Empreintes, 1994). À
l'aube de la métaphysique. Jalons pour une préhistoire de
la spiritualité Marc Groenen (Sciences-Croisées 7-8 pp. 1-19, 2011). Les
Religions de la Préhistoire André Leroi-Gourhan
(PUF, Quadrige, 1964). Les
premiers Sanctuaires de l'Humanité Marcel Otte (coord.) (Religions
& Histoire 2, mai-juin 2005, pp ; 10-69). À
l'aube spirituelle de l'Humanité Marcel Otte (Odile Jacob, 2012). L'Homme
et la mort : l'émergence du geste funéraire durant la
préhistoire Anne-Marie Tillier
(CNRS Éditions, coll. Le passé recomposé, 2009). |
|