Sections du site en Octobre 2009 :
Ajouts successifs d’articles -- Sujets d’articles à traiter – Pour
publier -- Post-Polio -- L'aide à domicile -- Internet et Handicap
-- Informatique jusqu’à 100 ans – Etre en lien -- L’animal de compagnie
-- Histoires de vie --
Donner sens à sa vie – A 85 ans aller de l’avant -- Tous
chercheurs -- Liens –Le webmestre.
RETOUR A LA PAGE D’ACCUEIL : CLIC AUTEURS, TITRES
DE TOUS ARTICLES : CLIC SYNTHESE GENERALE: CLIC
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Juillet 2015
PSYCHOLOGIE DE LA SOLITUDE
Gérard MACQUERON
Éditions
Odile Jacob, 2009 puis 2013
INTRODUCTION
À la fois théorique et très orienté vers la pratique de la lutte par soi-même, contre son sentiment de solitude, cet ouvrage est recommandé à qui se sent concerné. En voici des extraits ci-dessous..
Sur ce site, on trouvera notamment des références en fin de l’article :
Macqueron Gèrard,(2012) La psychologie de la solitude (
ouvrage, 2009) . Avec en fin de texte, 19 références d’articles déjà sur ce site
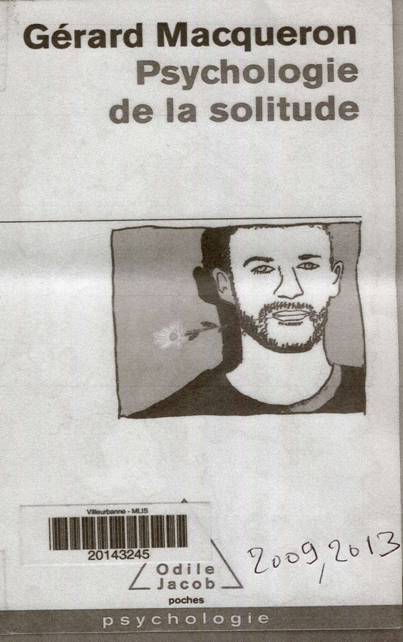
► Notre
société évolue
Les facteurs sociaux participent au phénomène. Nous ne
sommes plus dans une société de statut, où chacun a sa place définie et où la
solidarité est de type familial, mais dans une société de contrat, axée sur les
échanges, les réseaux, les liens que chacun doit construire et maintenir
lui-même. Autrefois l'existence communautaire de base (origine, travail,
loisir) permettait à l'individu d'être naturellement intégré à un groupe
d'appartenance au sein duquel il pouvait exister, s'exprimer, s'épanouir. La
famille jouait également un rôle prépondérant en favorisant les échanges
interpersonnels collatéraux (oncle, tante, cousin...). Aujourd'hui, la famille
est réduite à son minimum et tend encore à éclater.
Il existe dans notre société contemporaine un déficit de structures de
rencontres. L'individu se trouve face à lui-même et devient l'unique unité de
survie. La solution à l'isolement se trouve chez l'individu lui-même : dans sa
capacité à communiquer, dans sa volonté à aller à la rencontre de l'autre, dans
l'énergie qu'il va déployer pour tisser, construire et maintenir son réseau
relationnel. Il ne peut plus se laisser porter comme autrefois par les
structures mises en place au niveau de la communauté.
Nous l'avons évoqué, isolement et solitude ne sont pas superposables, néanmoins les personnes isolées sont inégalement touchées par le sentiment de solitude. Par exemple, à un niveau d'isolement relationnel identique, les chômeurs montrent un niveau de solitude supérieur aux retraités qui eux aussi ne travaillent pas. Pour les chômeurs, être sans travail place d'emblée dans une situation d'exclusion sociale. Le sentiment de solitude sous l'influence de la représentation sociale négative de l'isolement en question est plus intense. C'est la troisième grande notion que recouvre le terme de solitude : le fait de se sentir seul.
► Le sentiment
de solitude
Si la représentation
sociale négative est une composante importante de la souffrance liée au
sentiment de solitude, celui-ci tient beaucoup de la représentation psychique
que l'individu se fait d'une situation donnée et de la façon dont il la vit.
Subjectif par nature, ce sentiment échappe en partie à l'observation et reste
difficilement quantifiable.
Pour
certains, le sentiment de solitude
s'accompagne automatiquement de pensées négatives, d'émotions douloureuses et
angoissantes tel un manque, un vide à combler, un état de détresse intérieure.
D'autres éprouvent du plaisir à être seuls et vivent la solitude comme une chance que la vie leur
offre pour se ressourcer, être soi-même, vivre pleinement. Pour eux, sentiment de solitude rime avec bien-être, sérénité, calme
intérieur. S'agit-il du même sentiment ?
Pour
définir au mieux l'expérience de solitude et les sentiments qui en découlent,
commençons par prendre en compte et analyser les critères objectifs observables
qui fondent cette expérience
.
Nous n'avons pas appris
à être seul
« À chaque fois que
je me retrouve seul, cela se passe mal. »
« J'ai appris
beaucoup de chose, mais pas à vivre seul. »
« Pourquoi faire
les choses seul quand on peut les partager à deux ? »
« Pensez aux autres me permet de ne pas penser à moi. »
La solitude fait peur, parce qu'elle ravive en nous des souvenirs douloureux, mais aussi parce que nous n'avons pas appris à l'apprivoiser. Nietzsche l'avait souligné : « Le défaut le plus répandu de notre type de formation et d'éducation : personne n'apprend, personne n'aspire, personne n'enseigne... à supporter la solitude. »
Chacun s'emploie à ne pas être confronté à cette source de tant de
souffrances sans réfléchir sur la manière dont il pourrait apprendre à mieux la
vivre. Une des craintes des parents n'est-elle pas que leur enfant s'ennuie,
qu'il n'ait, seul, rien à faire ?
Dès leur plus jeune âge, nos enfants sont donc en activité permanente.
Les temps libres sont supprimés. L'oisiveté combattue. Cela a le mérite de les
stimuler. Mais si tel est l'objectif, diminuer le temps libre de l'enfant
augmente-t-il réellement ses performances ? Sera-t-il pour autant plus
tard un adulte plus éveillé, plus cultivé, plus épanoui ? Et quid de
la capacité de penser, du potentiel créatif, des désirs profonds de
l'enfant ?
Dans ce programme chargé, qui s'intéresse véritablement à ce qu'il
ressent, éprouve, vit intérieurement ? Qui apprend aux enfants à
comprendre leurs émotions, à identifier leurs besoins profonds, à verbaliser
leur ressenti ? Plus tard, adultes, comment pourront-ils rester seuls
s'ils ne l'ont jamais expérimenté auparavant ? Sauront-ils gérer ce face-à-face
avec eux-mêmes, sans angoisse ?
Pourtant,
c'est la solitude,
et pas l'accumulation des activités ou des apprentissages, qui permet d'avoir
une meilleure connaissance de soi, une conscience de soi plus juste, élément
indispensable à notre épanouissement personnel. Parce que nous n'avons pas
appris à apprécier la solitude, seule demeure en nous l'angoisse d'une solitude
amère, et tous les moyens sont bons pour y échapper. C'est dès l'enfance que
nous devrions éduquer nos enfants à supporter et à aimer la solitude. À nous,
parents, d'accepter de les voir parfois s'ennuyer, perdre du temps afin que
naissent les désirs, que se développent la créativité, le rêve.
L'expérience de la solitude et l'angoisse qui l'accompagne sont à rapprocher de l' « angoisse de castration » dont parlait Freud, de cette épreuve de la réalité qui remet à plat nos illusions et nous force à admettre qu'il ne suffit pas de désirer les choses pour les obtenir. Il nous faut renoncer « au principe de plaisir » et reconnaître la réalité, le fait que nos demandes ne seront pas toutes comblées, que les frustrations sont normales et structurantes, que tout ne tombe pas du ciel, mais qu'il nous faudra souvent patience et effort pour obtenir ce que nous souhaitons. Que malgré toute notre bonne volonté, notre ardeur, notre persévérance, certaines choses nous sont inaccessibles. Admettre que l'autre, quoi qu'il fasse, ne comblera jamais tous nos besoins.
Accepter
cette réalité : nous ne sommes ni le centre du monde ni des êtres
tout-puissants et immortels mais des individus parmi tant d'autres, vulnérables
et au pouvoir limité.
Renoncer
à l'omnipotence augmente nos capacités d'adaptation, améliore nos relations aux
autres, nous rend plus réactifs et plus efficaces. On ne règle pas les conflits
en imposant nos désirs, en imaginant que tout nous est dû, que rien ni personne
ne doit nous résister, en remuant terre et ciel pour obtenir l'impossible. La
vie n'est pas un caprice. Les autres ne sont pas des objets que nous manipulons
en fonction de nos désirs. Être adulte, c'est pouvoir distinguer ce qui est
possible de ce qui ne l'est pas, ce qui dépend de nous et ce qui dépend des
autres, différenciation qui vient avec la conscience accrue de nos propres
limites.
La
solitude nous apprend à accepter nos limites dans le but de vivre pleinement la
vie qui nous est donnée. L'acceptation n'est pas la résignation, l'abandon de
toute ambition. L'acceptation, c'est être réaliste et responsable. Changer ce
que l'on peut changer, s'adapter à ce qui peut l'être. Toutes les contrariétés
que la vie nous réserve, pour être dépassées, métabolisées, requièrent
l'acceptation d'une certaine frustration indispensable pour apprendre et
évoluer. Cette frustration reste une expérience solitaire.
C'est
ce qui est structurant dans l'expérience de solitude : nous inscrivons
alors nos désirs dans le champ du réalisable et non plus de l'imaginaire. Nous
acceptons que nos désirs ne soient pas tous compatibles entre eux, qu'ils
soient parfois fous ou préjudiciables à notre bien-être, qu'ils ne collent pas
systématiquement à ceux de l'autre.
La
responsabilité de soi est essentielle à l'épanouissement intérieur. Certes nous
avons tous besoin d'autrui, mais nous ne pouvons rendre les autres responsables
de nos difficultés, faire porter sur notre entourage la responsabilité de choix
que nous n'assumons pas. Nous ne pouvons pas nous épanouir et vivre libre
d'être nous même si nous vivions quotidiennement dans le secret espoir que les
autres nous donnent ce que nous n'osons pas réclamer. Être responsable de soi
ne signifie pas tout faire soi-même, mais se prendre en charge et assumer la
conséquence de ses actes. C'est à nous de décider de la vie que nous voulons.
Personne ne peut vivre à notre place ce que nous ressentons, nous comprendre
tout à fait, répondre à nos désirs.
L'expérience
de solitude nous conduit à chercher au plus profonde nous même les ressources
nécessaires pour agir, changer ou accepter de renoncer. Et ce face-à-face
étrange nous donne une juste valeur de nous même. Nous prenons conscience de
l'importance de nos actes, de notre vie. Nous réalisons que notre existence
dépend étroitement du sens que nous lui donnons.
Aussi,
n'attendez pas des autres qu'ils vous procurent ce que vous recherchez. L'autre
n'est pas tout puissant. Quel qu'il soit. Quoi qu'il fasse. Assumez vos besoins
et n'accusez pas les autres si vous n'êtes pas satisfait, interrogez-vous. Vous
ne pourrez évoluer si vous faites porter sur les autres la responsabilité de
votre incapacité à vivre pleinement votre vie.
Accepter l'autre tel qu'il est
« Mon
mal-être intérieur m'empêche d'apprendre les autres. Je les perçois à la
lumière de mes préjugés... ce que j'attends d'eux dépend de mes angoisses et
non pas de leurs possibilités... ni de leurs désirs... »
« Accepter
l'autre, c'est prendre le risque de ne pas être aimé. »
C'est
aussi parce qu'on a vécu ces moments de doute, d'incertitude, de déception que
l'on devient plus tolérant envers les autres. Eux aussi ont leur vie à
construire, eux aussi souffrent de ne pas toujours y parvenir, eux aussi
subissent les aléas de la vie.
Des conflits intérieurs
Souvent
la solitude s'accompagne du sentiment d'ennui ou d'inutilité. Personne à qui
parler. Rien à faire, sinon ressasser le passé. Mais qui nous empêche de lire,
écrire, sortir, voir du monde, sinon nous même ?
Parmi
ceux qui se sentent rejetés, non intégrés, délaissés, combien ont effectivement
été exclus ? N'est-ce pas plutôt parce qu'ils souffrent de solitude qu'ils
décident de se replier sur eux-mêmes, évitent de sortir et ruminent sans
parvenir à sortir de leur état ?
Quand
un jeune amoureux est éconduit, qui peut le consoler ? Ne se retrouve-t-il
pas seul au monde ? Voit-il tous ceux qui l'entourent, l'aiment et
pourraient le soulager ? Mais veut-il être soulagé ?
La solitude
est avant tout une expérience subjective qui n'est pas directement liée aux
facteurs extérieurs, mais dépend au contraire pour beaucoup de l’interprétation
que la personne se fait de la situation, de la compréhension qu'elle en a. La
solitude est donc le résultat de processus psychiques spécifiques qui
conduisent à provoquer ce sentiment dans certaines situations. Dans ce modèle,
ce sont des préjugés négatifs sur soi ou les autres,
les croyances fondées sur des expériences passées et inadaptées à la réalité
d'aujourd'hui, les attitudes réflexes d'évitement ou de retrait social qui
favorisent l'isolement.
Si la solitude est une problématique qui touche directement l'individu dans les rapports qu'il entretient avec lui-même avant de concerner la relation à l'autre, quelles sont les particularités psychiques des personnes qui en souffrent ?
Attitude constructive positive (coping
actif)
Cette attitude implique la mise en place d'une activité qui peut être physique (sport, gymnastique, yoga...), manuelle (bricolage, cuisine, rangement, couture...) ou bien intellectuelle (lecture, réflexion sur soi-même...).
Cette stratégie a pour avantage de nous occuper l'esprit, changer les idées, nous orienter vers l'action et moins vers les pensées (souvent automatiques) qui nous tourmentent quand nous sommes seuls. Elle ne se résume pas pour autant à une fuite en avant pour ne plus penser. Agir, c'est aussi réaliser des projets, mettre en place des choses qui nous font plaisir, avoir le sentiment d'exister et de se réaliser. Vous pouvez aussi profiter des moments de solitude pour faire ce que vous n'avez jamais le temps de faire (lire, écouter de la musique, regarder un DVD), prendre soin de vous (prendre un bain, faire de la relaxation), réaliser des rêves ou plus simplement faire des choses utiles et nécessaires au quotidien comme ranger, faire le ménage. Être actif, c'est pouvoir se fixer un objectif, se projeter dans l'avenir, être en interaction avec son environnement, mobiliser ses ressources, en vue de quelque chose. Et c'est justement ce mouvement introduit par l'action, qui change nos pensées, et provoque en nous une impression de mobilité qui nous détache du sentiment d'inertie et d’inutilité associé à la solitude. En outre, l'objectif atteint apporte une satisfaction, un bien-être.
Être
actif, c'est aussi accepter que toute action garde son importance même si elle
ne paraît pas intéressante en tant que telle a priori. Souvent, ceux qui
souffrent de solitude préfèrent ne rien entreprendre plutôt que faire des choses
simples. Ils recherchent pour s'occuper des activités extraordinaires,
intéressantes, importantes, valorisantes. Pourtant, cirer ses chaussures,
ranger la cave, lire le mode d'emploi d'un nouvel appareil ménager ont une
valeur intrinsèque, sont des actes utiles et parfois suffisants pour redonner
du courage et initier d'autres actions plus « enrichissantes ».
Mais l'attitude constructive positive, c'est aussi pouvoir réfléchir à sa situation et entreprendre des actions pour changer, ne plus souffrir de la solitude : par exemple, surfer sur Internet à la recherche d’informations, mettre en place un planning pour ne pas être surpris par un emploi du temps vide, prendre rendez-vous auprès d'un psychothérapeute... La liste est illimitée : lire, écrire, travailler, bricoler, dessiner, peindre, cuisiner, écouter ou jouer de la musique, ranger, sortir, marcher, faire du sport, aller au cinéma, à une expo...
Les chercheurs considèrent que ce comportement est sain car il nous aide à ne pas ruminer et nous permet d'avancer, d'avoir le sentiment d'exister. En effet, les personnes qui réagissent ainsi souffrent peu de la solitude ou de manière très ponctuelle. Pourtant les activités qu'elles mettent en place sont souvent effectuées sans compagnie particulière : lire, prendre un bain, méditer, bricoler sont des activités solitaires. Agir possède donc plusieurs fonctions : se changer les idées, se sentir vivant et utile, se faire plaisir, se réaliser, réfléchir sur soi-même pour évoluer... Agir permet de ne plus attendre impatiemment que le temps passe et donne du sens à ce que l'on vit.
Si vous souffrez de la solitude...
comment ne pas rester seul
Réagir quand vous êtes seul est fondamental pour lutter contre le sentiment d'impuissance et de fatalité qui accompagne les moments de solitude subie. La sensation de solitude peut être comprise comme un signal, vous avez besoin de vous rapprocher de vos proches, de créer des relations sociales ou affectives plus satisfaisantes. Un peu comme la faim et la soif vous poussent à chercher des aliments pour vous nourrir et de l'eau pour vous hydrater, la solitude vous pousse à chercher des « nourritures affectives » pour combler votre insatisfaction relationnelle. Aussi activer votre réseau relationnel quand vous êtes seul est une stratégie particulièrement efficace.
Consultez
votre répertoire et téléphonez à vos amis en commençant par ceux avec lesquels
vous êtes le plus à l'aise, en confiance, complice, et qui sont les plus
disponibles. Prenez de leurs nouvelles, écoutez ce qu'ils ont à vous dire,
racontez ce que vous faites, bavardez de choses et d'autres, même
superficielles et inutiles a priori, car l'important n'est pas d'être
intéressant, mais d'échanger, de passer du temps avec les personnes que vous
appréciez.
Rien
ne vous empêche de joindre de simples connaissances, des relations lointaines
justement pour les approfondir, faire plus ample connaissance. Plutôt que le
téléphone, utilisez alors Internet, moins intrusif, notamment sur les sites de
réseau social comme Facebook, MySpace
ou sur MSN.
Vous pouvez aussi sortir de chez vous et vous balader au hasard, vous arrêter à une terrasse de café, discuter avec un bouquiniste, fouiner dans une brocante et papoter avec le propriétaire des lieux... Souvent de simples rencontres inattendues apportent plus de réconfort que vous ne l'auriez imaginé.