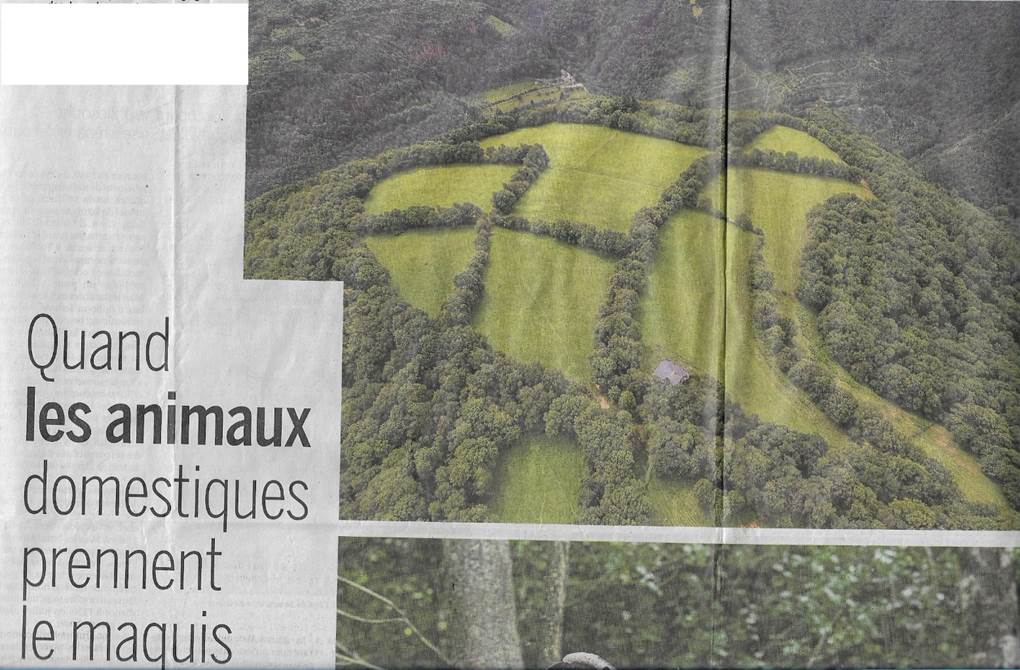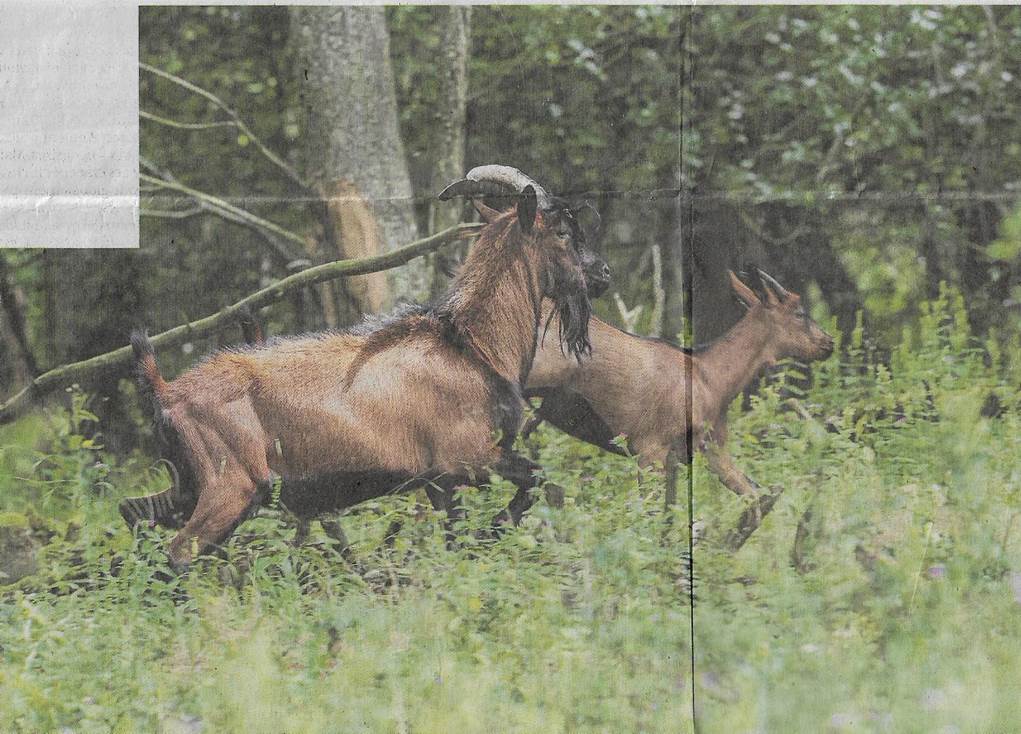Mai 2022
QUAND LES ANIMAUX
DOMESTIQUES PRENNENT LE MAQUIS
Florence ROSIER
Article paru dans Le
Monde du 27 octobre 2021
« La féralité désigne l'état de ce qui retourne à l'état
sauvage après avoir été domestiqué »
|
|
|
Vue aérienne du bocage et des gorges dans lesquels
se sont installés les chèvres et les boucs féraux. |
Liberté
contre servitude : c’est un peu l’histoire du loup, en écho à la fameuse
fable qui l’oppose au chien (La Fontaine, 1668). Ceux qui réussissent l’épreuve
de la fédéralisation, cependant, ne doivent pas faire oublier tous les recalés.
Quantité de cochons féraux, par exemple, ont péri de faim ou de soif, décimés
par des dingos ou des loups. « Des
plus faibles sont rapidement éliminés, reconnaît Dimitri Neaux,
postdoctorant en archéologie au Muséum national d’histoire naturelle (MNHN).
La première question est celle des
risques que ces animaux, après avoir pris la clé des champs, font peser sur
l’environnement, la flore et la faune. « L’attention portée aux populations férale est souvent liée à des
questions de conservation : comment vont-elles affecter les espèces
natives, et comment les contrôler ?, souligne
Marcelo Sanchez-Villagra, professeur de paléobiologie à l’université de Zurich
(Suisse). Exemple frappant, les cochons féraux, aux États-Unis, « ont fait décliner les populations
d’au moins 247 espèces de plantes et huit espèces d’oiseaux », écrit-il
dans son livre à paraître en décembre, The
Process of Animal Domestication (Les processus de la domestication animale,
Princeton University Press, non traduit). Mais d’autres populations férales,
tels les moutons de l’île de Santa Cruz (Californie), considérés comme des
réservoirs de diversité génétique, font l’objet de programmes de conservation.
|
|
|
Un chevreau et sa mère dans un sous-bois près de
Montredon-Labessonnié (Tarn), le 3 août. |
Sélection artificielle
Dans le Tarn, la prolificité des chèvres affranchies
suscite quelques craintes. « Elles pourraient transmettre à mes brebis
des maladies infectieuses comme la chlamydiose, qui provoque des avortements en
fin de gestation », s’inquiète Nicolas Delseau. Un autre éleveur, lui,
redoute la « pollution génétique » de la « pure race
pyrénéenne » de son troupeau, à la suite de croisements contrôlés avec ces
caprins dissidents.
Et puis, ceux-ci sont voraces. « Ils grignotent
les arbustes et mettent le rocher à nu de la gorge»,
note Gilbert Gros, président de la société communale de chasse. Autre
inquiétude : ce troupeau ne risque-t-il pas d’attirer Canis lupus ?
« Le loup est déjà à 60 kilomètres d’ici. Dans moins de dix ans, il sera
sur la commune », note Nicolas Delseau, fataliste.
Il y a aussi ce casse-tête réglementaire :
« Ce sont des animaux
domestiques non identifiés. Leur contrôle relève des maires, qui
sont désarmés », se désole Jean-Paul Chamayou. En février, il a publié un
arrêté municipal autorisant une régulation de ce troupeau par les chasseurs.
Mais des associations de défense animale sont montées au créneau :
« Tout a été gelé. » De quoi rendre chèvre. Mais aux dernières
nouvelles, la question est en passe d’être réglée grâce à la Fondation Brigitte
Bardot, sollicitée par le maire. Sa mission : capturer ces frondeuses pour
les placer dans des refuges.
Dans les Bouches-du-Rhône, l’Ariège, les
Pyrénées-Atlantiques… d’autres troupeaux de chèvres férales prolifèrent.
« Leurs avantages : richesse écologique et patrimoniale, entretien du
paysage. Les principaux dangers ? Risques sanitaires, dégâts aux cultures,
accidents de la route, et surtout une pollution génétique avec le bouquetin et
la chèvre domestique... », résumait, en mars, Jean-Noël Pascal, ethno
zoologue, dans la revue professionnelle La Chèvre.
L’archéologie, sur cette dernière question, offre un
certain recul. « La plupart du temps, nous érigeons une barrière entre
animaux sauvages et domestiques, analyse Rémi Berthon, du MNHN, comme si les
croisements entre eux enfreignait une règle mentale. En tant qu’archéologue,
cela m’interpelle : par le passé, ces croisements ont été fréquents. « Ils
ont même été à la base de l’élevage. « La domestication, c’est enlever une
partie du sauvage et sélectionner certains caractères. » Or cette
sélection artificielle appauvrit la diversité génétique des animaux
domestiques. Il faut donc impérativement, de temps à autre, réinsuffler de la
variété dans leur génome, sous peine de les voir péricliter par consanguinité.
Pour cela, les éleveurs croisent régulièrement leurs animaux domestiques avec
des bêtes sauvages, un processus nommé « retrempage », ou « introgression ».
Des croisements salutaires.
Quelles sont, maintenant, les adaptations qui ont
favorisé le succès de ces animaux émancipés ? Contrairement à ce qu’on
pourrait croire, « la féralisation n’est pas, par rapport à la
domestication, un retour en arrière. C’est vraiment un autre chemin
évolutif », explique Dimitri Neaux. La domestication consiste à sélectionner des
individus qui présentaient les caractères favorables à notre espèce :
production d’une viande de qualité, aptitude à courir vite… Résultat, la taille
des populations domestiquées a d’abord chuté. Et leur diversité génétique s’est
effondrée, seuls les caractères recherchés ayant été retenus. Puis elles ont
connu un essor important. Elles sont ainsi passées par un « goulot
d’étranglement génétique ».
Des
facteurs de stress
Quand, par la suite, certains animaux domestiques se
sont échappés dans la nature, leur patrimoine génétique était très appauvri,
par rapport à leurs ancêtres sauvages », explique Dimitri Neaux. Cela
pourrait en partie expliquer pourquoi « les animaux féraux conservent
souvent les traits morphologiques qui ont été sélectionnés lors de la
domestication », indique le professeur Eben Gering, évolutionniste à
l’université du Michigan (États-Unis). A cela s’ajoute le fait que
l’environnement où s’abritent les populations férales diffère notablement de
celui dans lequel, jadis, ont évolué leurs ancêtres sauvages.
Quels sont les plus grands facteurs de stress qui
s’exercent sur ces animaux émancipés ? « Tout dépend de chaque espèce
et de chaque environnement », résume Dominique Wright, professeur de génétique
à l’université de Linköping, en Suède.
Prenons les poules féraux qui peuplent par milliers l’île
Kauai, dans l’archipel hawaïen, depuis les tempêtes tropicales qui, en 1980,
ont libéré ces oiseaux. Hormis le chat et la voiture, les poulets féraux
subissent très peu de prédations sur cette île. Mais ils y sont soumis à une
forte pression de sélection sexuelle. « Nous observons toutes sortes de
changements, souvent surprenants, dans leurs12e ornements sexuels,
témoigne Dominique Wright. La taille de leur crête, en particulier, diminue
très vite à celle des coqs sauvages. » Un paradoxe, car « la
sélection sexuelle œuvre sans doute à agrandir cette crête, non à
l’amenuiser ». Son équipe a aussi trouvé, chez ces poulets féraux, la
réapparition d’un plumage qui ressemble à l’habit ancestral de la sauvagine
rouge.
Les processus génétiques en jeu, maintenant : ils
réservent une surprise. « La féralisation et la domestication modifient souvent les mêmes
caractères – par exemple, le taux de reproduction ou le
développement cérébral – mais elles agissent en affectant des gènes
différents », résume Eben Gering. Dit autrement, les gènes modifiés dans
la féralisation diffèrent souvent de ceux qui ont été modifiés par la
domestication, bien qu’ils contrôlent les mêmes caractères. Quittons maintenant
les espèces à plumes pour une espèce vêtue de laine. Petits et robustes, les
moutons féraux de l’île de Soay, un confetti battu par les vents, au nord-ouest
de l’Ecosse, y furent introduits par l’homme il y a plusieurs millénaires. Les
moutons mâles de Soay offrent un modèle d’étude de l’effet d’un gène (RXFP2)
sur la sélection sexuelle et naturelle. Un de ses allèles Ho -, lui, confère de
plus grandes cornes, est associé à un meilleur succès reproductif. L’allèle Ho
-, lui, confère de plus petites cornes, c’est pourquoi il a été sélectionné
artificiellement par la domestication ; il est associé, par ailleurs, à
une longévité accrue. Au final, les mâles féraux qui portent les deux allèles
(« hétérozygotes ») sont avantagés : l’issue d’un compromis
entre la sélection sexuelle et la sélection naturelle (Johnston, S.E. et al.
Nature, 2013). Chez les femelles, en revanche, l’allèle Ho – ne modifie pas la
survie.
Derrière ses cornes spectaculaires, le mouton de
Corse, lui, cachait un autre secret, révélé en 1979 par François Poplin, du
MNHN. Cet animal, en effet, ne constitue pas une espèce sauvage indigène.
« Il est né du marronnage 5féralisation] de moutons encore primitifs
introduits par l’homme dès le début du néolithique, au VIe, peut-être au VIIe
millénaire avant notre ère », expliquait ce chercheur. Retracée à partir
de l’analyse d’ossements, cette histoire évolutive a été confirmée par la
génétique.
Des
changements neurologiques
L’ancêtre du mouflon corse était donc un mouton
sauvage, originaire d’Asie mineure. Mais « après quelques dizaines de
siècles de domestication seulement, la population qui donnera le mouflon corse
est redevenue libre. Par rapports aux moutons domestiques actuels, elle a donc
moins divergé de l’espèce sauvage », explique Rémi Berthon. Les cornes de
cet ovin féral ont la particularité d’être enroulées autour d’un seul axe, un
caractère que devait présenter le mouton sauvage ancestral, et que la courte
phase de domestication n’a pas transformé. Notre mouflon corse, par ailleurs,
n’est pas revêtu de laine. « La toison n’est apparue que beaucoup plus
tard dans la domestication du mouton », note Rémi Berthon.
Les comportements
aussi changent chez les animaux féraux.
« C’est même un des caractères les plus prompts à changer », souligne
Dominique Wright. Si la domestication a souvent réduit les comportements de
peur, les affrontements physiques et la réactivité des animaux – pas toujours,
comme le montrent les taureaux -, la féralisation de son côté, a pu avoir des
effets variés. Par exemple, les poulets féraux montrent davantage de
comportements d’anxiété, mais également une fréquente diminution de la peur des
humains. Quant aux chats féraux (dits « harets »), ils ont un système
social très différent des chats domestiques, formant de vastes colonies
territoriales.
Pour conquérir de nouveaux environnements, il faut une
certaine plasticité comportementale. Or la domestication s’est accompagnée,
chez les mammifères, les oiseaux et les poissons, d’un phénomène peu
connu : elle a réduit la taille du cerveau. Cette fonte cérébrale est
« attribuée à la relative simplicité des environnements domestiques et à
la sélection artificielle en faveur d’une docilité et d’un apprivoisement »,
soulignent les auteurs d’un article de synthèse sur la féralisation (Gering E.
et al., Trends in Ecology & Evolution, décembre 2019).
La féralisation n’a que
partiellement induit le phénomène inverse. « Chez les mammifères féraux, la taille de cerveau tend à ré augmenter, sans pour
autant revenir à la taille du cerveau de leurs ancêtres sauvages », résume
Marcelo Sanchez-Villagra. Trois raisons possibles à
cela. L’évolution aurait pu être entravée par un manque de diversité génétique,
on l’a vu. Par ailleurs, « beaucoup d’animaux féraux vivent dans des
écosystèmes appauvris, sans prédateurs ni compétiteurs, ce qui pourrait
influencer la taille de leur cerveau », souligne le paléo biologique
suisse. Autre hypothèse, la période de temps analysée aurait été trop courte.
Le
temps d’un soupir
Prenons les cochons féraux
d’Australie, « Sur ce continent, il n’y avait ni cochons ni sangliers
avant l’arrivée des colons anglais, à la fin du XVIIIe siècle. Tous
les Suidae actuels proviennent donc d’élevages importés », relève Dimitri
Neaux. D’apparence, ils ressemblent à des sangliers : ils ont récupéré des
soies grises. Mais derrière cette enveloppe ? Les crânes et les mandibules
des bêtes férales sont globalement plus petits que ceux des sangliers
ancestraux, a montré ce chercheur (Neaux, D. et al., 2020). « C’est à la
race domestique rustique [landrace] que ressemblent le plus nos cochons
féraux. »
Sur le long terme, cependant, l’évolution peut avoir
des effets sensibles, souffle l’exemple des dingos, ces chiens ensauvagés qui
colonisent l’Australie et l’Asie du Sud-Est depuis 3000 à 8600 ans.
« Leurs cerveaux sont plus gros et développés que ceux des chiens
domestiques de taille corporelle similaire, bien que la variation entre races
canines complique ces comparaisons », écrivant les auteurs de la revue
citée plus faut (Trends in Ecology & Evolution, 2019). Rapporté à la taille
corporelle, le cerveau des dingos reste proportionnellement plus petit que
celui des loups.
La féralisation peut entraîner des changements plus
subtils. En témoigne le système olfactif des cochons féraux : ses
capacités sont intermédiaires entre celle des sangliers sauvages et des cochons
domestiques. Si la densité de cellules, dans la muqueuse olfactive des cochons
ensauvagés, est comparable à celle des sangliers, elle produit en moins grande
quantité une protéine importante dans l’olfaction, tout comme les animaux
domestiques (Maselli V. et al., Italian Journal of Zoology, 2014).
Revenons aux succès de la féralisation. « Ce qui me surprend le plus, c’est
que les animaux féraux soient capables de s’adapter si facilement et de
prospérer dans des environnements très perturbés par les activités humaines,
confie Eben Gering. Ils parviennent à trouver où dormir, quoi manger, avec quel
partenaire s’accoupler, et cela, même au milieu des zones urbanisées, du trafic
routier, des armes et des pièges humains... »
« Le plus étonnant à mes yeux, c’est la vitesse
d’adaptation de ces animaux féraux, renchérit Dominique Wright. En seulement
quarante à cent ans, les poulets d’Hawaï et des Bermudes, par exemple, sont
passés d’une apparence de poulets domestiques à celle de la sauvagine
rouge. » Soit le temps d’un soupir, à l’échelle évolutive.
Une période trop brève, en réalité, pour permettre la
sélection de nouvelles mutations. D’autres mécanismes pourraient donc être à
l’œuvre, comme des modifications dites « épigénétiques » de
l’ADN : par exemple, l’ajout de groupements chimiques (méthyls ou autres)
sur des sites précis du génome. En théorie, ces processus permettent de
remanier rapidement l’expression de nombreux gènes, en réponse à un nouvel
environnement, d’où une possible adaptation rapide.
Souples, réactifs et réversibles, ces processus
épigénétiques opèrent-ils aussi dans la féralisation, comme c’est le cas dans
la domestication ?. L’équipe de Dominic Wright
s’est lancée sur cette piste en suivant son animal fétiche : le poulet
d’Hawaï. L’aile (génétique) ou la cuisse (épigénétique), il faudra choisir.
■
FLORENCE ROSIER