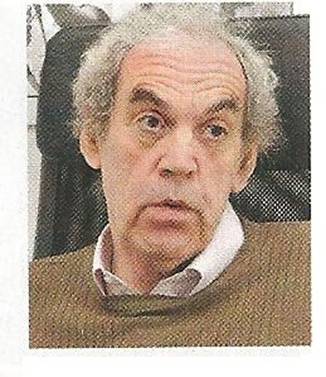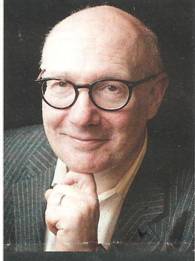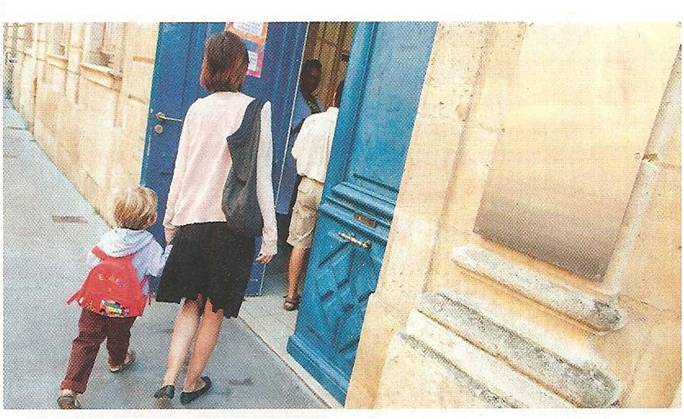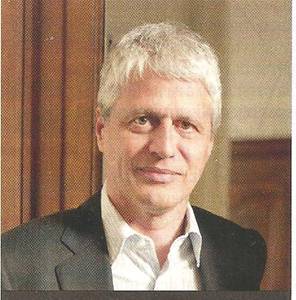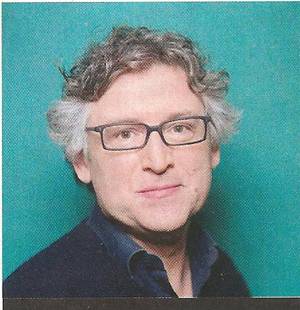Sections du site en Octobre 2009 :
Ajouts successifs d’articles -- Sujets d’articles à traiter – Pour
publier -- Post-Polio -- L'aide à domicile -- Internet et Handicap
-- Informatique jusqu’à 100 ans – Etre en lien -- L’animal de compagnie
-- Histoires de vie --
Donner sens à sa vie – A 85 ans aller de l’avant -- Tous
chercheurs -- Liens –Le webmestre.
RETOUR A LA PAGE D’ACCUEIL : CLIC AUTEURS, TITRES
DE TOUS ARTICLES : CLIC SYNTHESE GENERALE: CLIC
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Janvier 2015
LE TRIOMPHE DES MAL-ÉLEVÉS
Impolis,
goujats et sans-gêne imposant leur loi. Enquête sur les fossoyeurs du respect.
LE POINT, 17
juillet 2014
Introduction.
Cet article est constitué des contributions à l’enquête, de Violaine de
MONTCLOS, Frédéric ROUVILLOIS, Hervé DENYONS, Louise CUNEO, Sébastien ROCHÉ,
Michel ONFRAY.
«
En France, vous réservez votre politesse à vos proches »
|
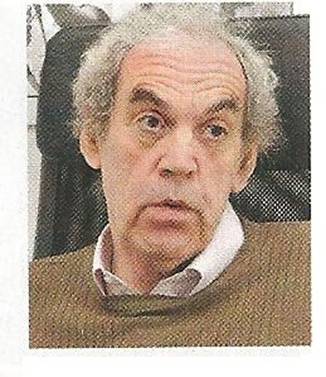
|
|
Shocking ! Le journaliste
anglais John
Lichfield.
|
John Lichfield, correspondant
en France depuis dix-sept ans du quotidien britannique The Independent,
n’a jamais oublié sa première visite à Paris, séduit par la ville mais sidéré
par l’impolitesse crasse de certains de ses habitants. « Nous demandions
aimablement notre chemin au guichet d’une station de métro, on nous répondait
“il y a des plans pour ça”, raconte-t-il en riant. J’avais 14 ans et je
n’en revenais pas, tout était du même acabit, alors qu’on m’avait tant parlé de
la stricte étiquette, de la parfaite courtoisie des Français. Cela fait des
années que je vis ici, mais, que ce soit à Paris ou en province, je ne me suis
jamais tout à fait habitué à cette brutalité. Sur un trottoir étroit, si on
s’efface pour laisser passer le piéton d’en face, il ne vous remercie pas. En
voiture, si on cède le passage à un autre automobiliste, il ne daigne pas vous
faire un sourire. L’autre n’existe pas. En Angleterre, ce genre de comportement
est inconcevable. »Aux amis étrangers de passage, souvent ébranlés par
cette rudesse autochtone, Lichfield tente d’expliquer que ce « so shocking » manque de savoir-vivre n’est pas, de
loin, réservé aux touristes. Il a sa théorie : « Contrairement aux
Anglo-Saxons, vous faites en France une distinction très nette entre les gens
que vous connaissez, auxquels vous réservez votre sens de l’amabilité et de la
politesse, et les autres. Quand on fait partie de votre cercle, vous êtes
charmants. Mais, avec le voisin, le passant, le client anonyme, c’est une autre
affaire.»
Dans un livre qui eut en 2012
un succès monstre aux Etats-Unis puis au Royaume-Uni,«
Elever bébé, une mère américaine découvre la sagesse de l’éducation à la
française »,la journaliste du Wall Street Journal Pamela Druckerman, expatriée dans l’Hexagone, s’émerveillait
pourtant de l’exquise politesse des petits Frenchies,
capables de dite « merci monsieur », « bonjour madame » et de rester sagement assis à table à un âge
où les jeunes Américains et les petits Anglais sont incontrôlables. Lichfield,
dont les enfants ont grandi ici, confirme : « C’est vrai, et c’est
paradoxal. Vos enfants sont beaucoup mieux élevés que les nôtres. En présence
de leurs parents, ou de leurs professeurs, ils se tiennent bien, disent
bonjour, connaissent toutes sortes de formules de politesse. Mais dès que les
adultes tournent les talons, au square ou dans la cour, franchement, ils se
comportent entre eux avec une brutalité que l’on ne voit pas en Angleterre. De
vrais petits sauvages. » Et de futurs aboyeurs de guichet ou des malappris
des transports en commun. Des Français en somme… ■
VIOLAINE DEMONTCLOS
|

|
|
« So rude ». À l’inverse de la maire de Paris, la reine
d’Angleterre ne trouve personne pour l’abriter.
|
************************************************************************
Frédéric
Rouvillois : « Notre sensibilité à l’impolitesse
s’est exacerbée »
Clés. Professeur de droit public à l’université Paris-V,
Frédéric Rouvillois décode la montée de l’incivilité.
Le Point :
Sommes-nous vraiment moins bien élevés qu’autrefois ?
Frédéric Rouvillois : À première vue, la réponse est oui. Une série de
principes et de codes qui étaient considérés comme allant de soi sont de moins
en moins respectés. Selon tous les sondages, la politesse est la valeur à
laquelle les Français accordent le plus d’importance et celle dont ils estiment
manquer le plus. Pourtant, l’impression d’une montée brutale des incivilités
est à nuancer. Notre sensibilité à l’égard de l’impolitesse s’est exacerbée.
Subir des rapports sociaux, rugueux, con-flictuels
est extrêmement déstabilisant quand la vie est par ailleurs difficile.
À vous écouter, le besoin de politesse serait lié à la crise économique !
La crise a remis la politesse à
l’honneur. Pendant une bonne partie du XXe siècle, la politesse a
été une valeur déclinante. Ce déclin a commencé au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale. Pendant les Trente Glorieuses, la po-litesse
est jugée archaïque, dépassée. Mai 68 marque l’apogée de ce décrochage. Dans
les années 70, seulement 30 % de la population pense que la politesse est une
valeur à transmettre aux générations futures. Depuis le milieu des années 80,
on observe une prise de conscience généralisée de l’im-portance
de la politesse. Plus on est dans une position socialement ou économiquement
fragile, plus on accorde d’im-portance à la
politesse. Et puis, si l’on est im-puissant face à la
crise, améliorer la vie en so-ciété est relativement
aisé. Etre poli, c’est simplement prendre l’au-tre en
considération.
Au fait, quand l’huma-nité a-t-elle inventé la politesse ?
La
politesse apparaît dès qu’il y a relation sociale. Elle fait partie, avec le
langage et le droit, des trois éléments con-substantiels
à la vie en société. Parce qu’elle est humanisante,
la politesse est universelle, même si elle s’exprime de façon différente selon
les cul-tures. La politesse est nécessaire, jusque
dans les groupes sociaux les plus restreints. Sans savoir-vivre minimal, la
famille devient un groupe de colocataires qui n’at-tend
qu’une chose, la fin du bail. 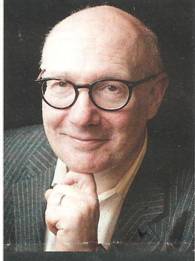
Aujourd’hui,
qui donne le « la », qui « fait exemple » ?
La politesse
est toujours venue de groupes particuliers, à l’avant-garde, considérés comme
suffisamment respectables pour être suivis. Ils inventaient un usage, qui était
ensuite repris dans les manuels de politesse et qui, à partir de là, se
diffusait dans la classe dominante, puis la classe moyenne… Prenez le baisemain.
Il apparaît autour de 1900, en France, dans deux ou trois salons parisiens qui
considèrent que la politesse s’amenuise et décident d’utiliser cet usage
importé d’Europe de l’Est. Dans les années qui suivent, le baisemain se répand,
se codifie et, en quelques décennies, devient le nec plus ultra de la politesse
à la française sans posséder la moindre racine hexagonale. De nos jours, les
prescripteurs de savoir-vivre sont la télévision, les journaux people, le blog
des personnalités influentes et les manuels de politesse, comme ceux de Nadine
de Rothschild.
Mais
notre mode de vie nécessite de simplifier les codes de politesse.
Nos codes de
politesse remontent à l’après Révolution française, une époque où l’on avait le
temps, ils ne sont donc plus adaptés à notre rythme de vie. En fait, peu
importe que le code change, ce qui compte est de manifester du respect envers
l’autre. Je ne suis pas impoli si je
n’utilise pas une formule de politesse à rallonge à la fin de mon courriel. Je
le deviens si, au motif de la vitesse croissante des rapports sociaux, je commence
mon courriel sans la moindre formule de politesse, comme si je ne m’adressais
pas à un être humain mais à une machine.
Mais la
politesse peut aussi traduire la peur de l’autre. En poussant le raisonnement, une société extrêmement polie peut être
extrêmement violente…
Une
société extrêmement polie n’est pas une société violente mais méfiante. On se
méfie de l’autre, de sa tendance à déraper, à dérailler. Dans le métro, sur
certaines lignes, à certaines heures, on évite de se regarder dans les yeux, on
ne veut pas avoir de problèmes. C’est une peur légitime. On glisse vite de l’incivilité
à la violence, alors on polit les rapports sociaux pour éviter les frictions
qui pourraient conduire à la violence. La politesse permet de se prémunir
contre la violence d’autrui. C’est pourquoi la politesse n’a rien à voir avec
la morale ni avec la gentillesse. Être poli, ce n’est pas être gentil, c’est
faire preuve de prudence sociale.
Seule une société angélique pourrait se passer de politesse, car spontanément
les gens s’arrangeraient pour éviter tout conflit. Plus la société est dure,
plus la politesse est nécessaire, car plus la menace de basculer dans la
barbarie est grande.
Les actes d’incivilité ne finissent-ils pas par se retourner contre
leurs auteurs en les coupant du reste de la société ?
L’impolitesse
est un luxe réservé aux classes les plus aisées de la société. Cela a toujours
été ainsi. Les duchesses adoraient dire des gros mots et se comporter de
manière impolie, car cela ne pouvait pas les déclasser, remettre en question
leur fortune ou leurs pri-vilèges. À l’inverse, quand
on appartient à une classe défavorisée, l’apprentissage et l’usage de la
politesse sont absolument nécessaires, ne serait-ce que pour exister dans le
monde du travail. Sinon, cela empêche d’évoluer d’un groupe social à un autre,
de profiter de l’ascenseur social.
Êtes-vous favorable au cours de « civilité » à l’école pour apprendre
aux enfants les règles de la vie collective ?
Pourquoi
pas, mais, si les codes appris à l’école sont ignorés ou bafoués en famille,
cela ne sert à rien. La politesse s’ap-prend en
famille. Comme une langue, il vaut mieux commencer au berceau, sinon
l’apprentissage né-cessite beaucoup plus d’efforts.
Ensuite, connaître les règles de la politesse ne conduit pas forcément à
respecter l’autre.
La politesse est moribonde, peut-elle ressusciter ?
La
politesse est en piteux état, mais, si elle était moribonde, cela signifierait
que l’avenir de notre société serait compromis. Dans la mesure où nous ne
sommes pas devenus des anges, nous serions sous la menace d’une dissolution du
lien social aux conséquences cataclysmiques. On l’a constaté aux époques
révolutionnaires : quand les barrières sociales sautent, l’animalité
resurgit très vite. Pendant la Terreur, par exemple, les codes anciens sont
cassés, les nouveaux pas encore établis, c’est la loi de la jungle, tout le
monde fait ce qu’il veut. Sous le Directoire, entre 1795 et 1800, on assiste à
un débraillé généralisé des mœurs, des usages… On voit des femmes se promener
nues dans les rues. Puis la société se ressaisit et remet des règles en lace.
La politesse ne revient pas toute seule, c’est un effort collectif. Mais avoir
conscience qu’elle nous manque est déjà bon signe ! ■
PROPOS RECUEIL-LIS PAR OLIVIA RECASEN
********************
Ces
parents d’élèves qui insultent les profs
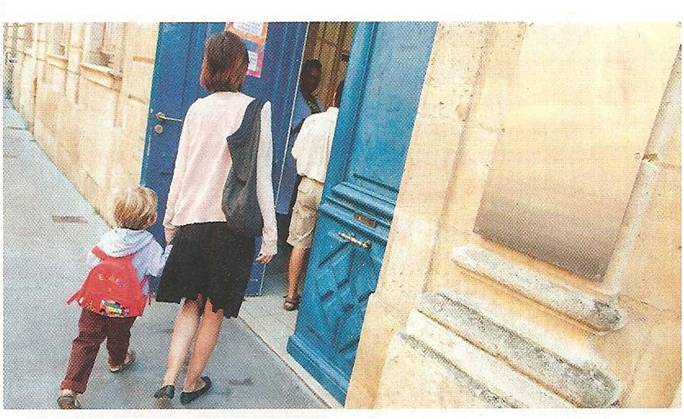
Déchaînement. À l’école, plus d’une agression sur deux serait le
fait des tuteurs.
« Non mais t’as vu cette
salope, elle a déplacé mon fils ! »
Ce cri de rage d’une mère lors d’un spectacle de fin d’année a été audible par
tout le public, y compris la maîtresse visée. Son « tort » : avoir
changé de place un élève chahuteur.
Contrairement aux idées reçues,
les plus impolis à l’école ne sont pas les jeunes, mais leurs parents. 54 % des
actes de violence sur un enseignant sont le fait des tuteurs, note Anna Topaloff dans « La tyrannie des parents-élèves » (Fayard, à
paraître le 27 août). Auteur d’une vaste enquête sur les relations école-parents,
Georges Fotinos insiste : 7 enseignants sur 10
déclarent avoir eu plusieurs différends avec les parents dans l’année. Un
phénomène qui se généralise, à tel point que lorsque la MAIF, la mutuelle
historique des enseignants, a lancé en 2012 une assurance pour parer aux
conséquences d’agressions par des parents d’élèves, 55 % des profs l’ont
souscrite. « Ce sont d’abord les tuteurs qui sont discourtois, confirme
le directeur d’une école primaire parisienne. Certains ne me disent pas “bonjour”, ou arrivent
en retard sans s’excuser… »
Sophie, enseignante
d’histoire-géographie dans un collège de banlieue parisienne, raconte,
choquée : « Une mère m’a accusé de “porter atteinte à l’intégrité et à
la dignité des enfants”, parce que j’avais refusé que sa fille se rende aux
toilettes pendant un cours. Une autre m’a hurlé dessus au prétexte que je lui
faisais “perdre son temps” en la convoquant pour parler de son fils. On perd la
tête ! »
Les sondages tout comme
l’Observatoire de la violence à l’école reconnaissent une « montée des
incivilités » ; l’Éducation nationale tente de réagir. En 2008, le
ministre Xavier Darcos a voulu inscrire l’apprentissage des règles de politesse
dans les programmes scolaires. Quant à Vincent Peillon,
il a œuvré pour un enseignement moral et civique ; il sera mis en place
dès la rentrée 2015. pour Emmanuelle Maître de
Pembroke, maître de conférences en
sciences de l’éducation à l’Espe de Créteil, « les
incivilités à l’école sont dues à une difficulté pour les élèves — et leurs
parents — à comprendre le sens des codes requis par l’institution. Tout le
monde sait qu’il faut dire “merci”, mais il n’en va pas de même pour les microgestes, les postures ou les regards : faut-il
regarder un adulte dans les yeux ? Cela dépend des cultures. C’est à
l’enseignant d’expliciter les codes ». mais ces
maladresses n’expliquent pas tout. De fait, les parents jouent un rôle clé dans
la relation des jeunes à l’école. Les adultes ont un avis tranché sur les
enseignants et les programmes et tentent, par ce biais, d’instaurer une
complicité entre eux et leur progéniture. Au risque de réduire à néant
l’autorité de l’institution. Comme le préconise le rapport de la mission
d’information sur les relations entre l’école et les parents, il faut favoriser
le lien école-famille. Et replacer les familles du bon côté : celui des
profs ■ LOUISE CUNÉO
Ce que subissent les urgentistes…

Témoignage.
Le docteur Dumont s’alarme de l’agressivité croissante
des patients.
PAR HERVÉ DENYONS, À MONTPELLIER
Le service des urgences de l’hôpital de
Montpellier est assuré par une trentaine de personnes travaillant par vacations
de douze heures : secrétaires, aides-soignants, infirmiers, médecins et
même désormais deux vigiles en cas de problème avec les patients ou les
accompagnants. Chaque jour, les équipes doivent prendre en charge entre 70 et
140 cas.
Le docteur
Richard Dumont, anesthésiste-réanimateur âgé de 58 ans, est le médecin
coordinateur du service. Il a débuté aux urgences en 1984 et témoigne : «
Je constate une montée de l’impolitesse ou de l’incivilité depuis deux
décennies. À mes débuts, il y avait ce qu’on appelle le respect de la blouse
blanche. Maintenant tout a changé. Médecin comme infirmier, chacun se retrouve
régulièrement agressé verbalement pour parfois presque rien. Cela débute avec
les appels au 15, le numéro d’urgence. À Montpellier, ce numéro reçoit de 800 à
2800 appels quotidiens, selon les périodes. Tous les jours, nous en avons au
moins 10 qui dérapent. Scénario classique : on nous décrit une pathologie
mineure, donc nous conseillons la personne ou lui disons de venir par ses
propres moyens et là, n’ayant pas obtenu satisfaction, elle explose. Cela va
de : “Je vais venir vous casser la gueule” à “bande de connards”,
“enculés” ou même pire. La violence verbale est hélas devenue banale et
concerne tous les types de patients. Parfois, lorsqu’on voit arriver après, on
constate que ce sont des gens issus d’un bon milieu ou âgés. Mais au téléphone
ils se lâchent. Je pense que ces gens considèrent les soins d’urgence sont un
droit et que, à partir du moment où on n’accède pas à leur demande, ils se
croient tout permis. Le rapport aux urgences a changé, d’autant que dans de
nombreuses villes c’est un service gratuit. Chez beaucoup, cela veut
dire : “J’y ai droit et j’ai le droit de dire si je ne suis pas content.”
Dans les interventions sur le terrain, les insultes ou incivilités sont
heureusement moins présentes. Certaines peuvent être mises sur le compte du
stress.
|
«
Face à la violence, nous
sommes
parfois obligés
de
porter plainte. »
|
Concernant l’accueil aux urgences, là aussi, les choses ont dégénéré.
Dès que les personnes ont l’impression que d’autres passent devant elles ou que
qu’on ne s’occupe pas d’elles, cela peut mal tourner. On a même régulièrement
des patients qui inversent les dossiers pour passer en priorité, dans une
logique de premier arrivé premier servi, alors qu’évidemment les urgences ne
fonctionnent pas ainsi. Là encore, les insultes sont souvent violentes, voire
menaçantes. Et nous sommes parfois obligés de porter plainte. Il faut
comprendre que, pour le personnel administratif et soignant, c’est très
traumatisant, c’est comme une gifle. Vous êtes là pour assister quelqu’un et
vous subissez une véritable agression. Certains ont préféré quitter le service
à cause de cela. »
Cellules
de contact. « Quand des incidents de
ce type se produisent, nous en parlons avec le personnel et nous organisons
même des séances de préparation de groupe avec des comédiens pour nous habituer
à gérer ce genre de rapports. Ce qui est navrant, c’est que les plus grossiers
sont évidemment les moins gravement atteints. L’impolitesse semble se
banaliser, comme si parler mal à quelqu’un était justifié lorsqu’on pense ne
pas être compris. C’est presque un mode de communication pour certains.
Nous avons dû placer des vigiles à l’accueil, le personnel
administratif travaille derrière des vitres et, pour faire en sorte que rien ne
dégénère, en particulier avec les accompagnants, nous avons organisé une
cellule de contact aux entrées avec un médecin coordinateur et un infirmier dès
que le ton monte. Les gens supportent également de moins en moins d’attendre et
s’énervent plus vite qu’avant. Peut-être est-ce dû au fait que notre société
nous habitue à penser qu’on peut tout avoir tout de suite. Et aux urgences nous
accueillons toutes les composantes de la société. Cela dit, j’insiste,
l’impolitesse n’est pas du tout le signe de telle ou telle catégorie, c’est
devenu un mode de fonctionnement pour certains, d’où qu’ils viennent. » ■
************************************************************************
Sebastien Roché : « En ville chacun apporte
ses règles »
Fractures.
Pour le
spécialiste de la délin-quance, le vivre-ensemble
cache une indifférence à l’autre.
Le Point : Vous avez été le premier en France à parler de « société incivile »
en 1996.
Sebastien Roché : Je travaillais au début des années 90 sur le
sentiment d’insécurité. Les habitants des quartiers difficiles auprès desquels
j’enquêtais revenaient sans cesse sur les salissures dans les halls, les
ascenseurs transformés en urinoirs, les groupes de jeunes devant les entrées
d’immeuble. J’ai utilisé le terme d’incivilité pour parler de ces frictions
entre les gens sur l’utilisation des espaces communs et dont les acteurs
cherchent à ne pas entrer en relation avec les autres.
Pourquoi
ne pas vouloir entrer en contact avec l’autre ?
C’est le principe
de la ville. L’espace n’y est pas conçu comme étant partagé, mais comme un lieu
où les gens doivent apprendre à s’ignorer les uns les autres. La règle à la vie
urbaine, c’est l’ignorance mutuelle, le jeu consiste à faire comme si on était
seul, vous prenez le métro, vous ne dévisagez pas les gens, vous êtes concentré
sur le fait d’ignorer avec qui vous êtes. Le principe du vivre-ensemble, c’est
le principe d’être indifférent aux autres.
La ville
crée-t-elle des incivilités ?
La ville
fait vivre ensemble des groupes qui ont différentes perceptions de ce qui est
bien ou mal ; les incivilités des uns seront la liberté des autres. Dans
la ville, il n’y a pas de communauté, les gens ne se connaissent pas, ne se
rassemblent pas pour décider des règles du partage de l’espace urbain, qui
n’appartient à personne. Chacun apporte ses règles dans les lieux. Au contraire
du village traditionnel, où tout le monde se connaît et où la collectivité
s’autorégule et institue ses règles. Mais, dans la ville, qui doit réguler les
différents types d’espace ? Quand vous écoutez de la musique fort, dehors
ou chez vous, vous créez un espace partagé. Qui va réguler cet espace sonore
commun ?
Il est très compliqué de gérer des relations
avec des personnes avec qui on n’a rien en commun. Les incivilités touchent à
la qualité de la relation à autrui. Un reproche sera immédiatement perçu comme
une intrusion inacceptable dans la vie privée, une attaque de ses droits. Pour
établir un dialogue, il faut du collectif, créer des groupes où des gens
puissent échanger, faire exister des formes de vie à l’intérieur des immeubles,
actions auxquelles tout le monde n’a pas forcément envie de participer. Dans un
immeuble, après une journée de travail et du temps dans les transports, les
gens cherchent à minimiser les relations avec les autres, car c’est un espace fonc-tionnalisé. On travaille à un endroit, on fait ses
courses dans un autre endroit, on se repose dans un troisième. Si quelqu’un est
mécontent de ses voisins, il écrira à l’office HLM ou au syndic de l’immeuble
pour régler les problèmes. Cela renvoie à l’absence de communauté pour fixer
les règles.
|
«
Un reproche peut être perçu comme une instruction dans la vie privée, une
attaque de ses droits. »
|
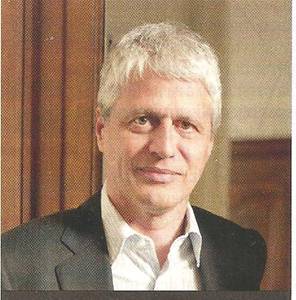
|
Sébastien Roché,
sociologue.
Auteur de « La
société
incivile » (Seuil).
|
Comment
font les entreprises con-cernées par les
incivilités ?
Elles
ont commencé par se charger de la régulation des comportements pour devenir le
garant des lieux, mais il leur a fallu du temps. À l’origine, la SNCF ne
faisait que transporter des voyageurs ; aujourd’hui, elle organise aussi
la manière de partager l’espace du wagon. Elle a ainsi codifié l’usage des
téléphones portables. Jusqu’aux années 80, les chefs de gare faisaient circuler
des trains ; désormais, ils font circuler les voyageurs avant qu’ils
montent dans le train,
L’entreprise
ne se contente plus de vendre un produit, billet de train ou de cinéma, elle
doit organiser l’espace avant et pendant l’utilisation du service. C’est
quelque chose de nouveau. Car la fréquentation des espaces s’est massifiée.
Aujourd’hui, les lieux doivent être structurés pour tenir compte de ces flux et
de leur diversité avec des perceptions et les opinions différentes sur la
manière de se comporter. Ce n’est plus l’État qui fait les règles de la
société, mais les entre-prises.
Cela conduit à ce que vous
appelez la « société d’hospitalité » ?
On a besoin de
règles d’hospitalité. Il faut des règles pour permettre de partager quelque
chose, un immeuble, un wagon, une école, des règles pour être avec les autres
mais pas trop, parce qu’on n’a pas envie de tout partager avec tout le monde ■
PROPOS RECUEILLIS PAR ALIX RATOUIS
Michel
Onfray : « Combattre l’incivilité,
c’est résister à la barbarie »
Ethique. En adepte de l’hédonisme volontariste, il fustige le
chacun-pour-soi qui nous fixe dans l’errance post-soixante-huitarde.
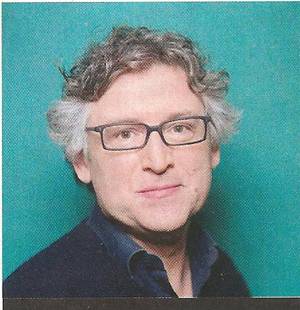
|
Michel Onfray, philosophe.
Auteur de « Le réel n’a pas
eu
lieu » (Autrement).
|
Le Point : Faut-il voir dans la montée des incivilités un indicateur du degré
de notre civilisation ?
Michel Onfray : La politesse est le premier degré de la morale, elle
est le signe éthique par excellence. Par elle, on dit à l’autre qu’on a vu
qu’il existait et qu’on prend en considération sa présence, donc son
existence : en train, par exemple, téléphoner sur la plate-forme au lieu
d’infliger l’indigence de sa conversation à une vingtaine de personnes est un
geste éthique, un acte moral. L’incivilité existe aussi dans les voitures de
première classe, pas seulement dans les banlieues, qui, hélas, concentrent les regard en la matière.
L’incivilité
est-il un mal occidental , ?
Je
ne connais pas assez les mondes non occidentaux pour pouvoir vous répondre avec
certitude… Disons que l’état dans lequel se trouve l’Occident, à savoir non
plus le déclin comme au temps de Spengler mais l’effacement, fait qu’il existe
une relation intime entre incivilité et mal occidental.
Le
triomphe du chacun-pour-soi serait-il le dernier avatar du libéralisme
sauvage ?
La fin de
tout ce qui faisait communauté (la religion avec le judéo-christianisme et la
politique avec les idéaux marxistes) a laissé place au nihilisme d’une époque
dans laquelle, en effet, l’argent fait la loi. Le libéralisme, en tant qu’il
suppose les pleins pouvoirs du marché, a substitué des valeurs aux « valeurs »
anciennes : l’idéal se trouve moins dans le prêtre ou dans le militant que
dans légotiste, qui se permet tout.
Mais
jouir aux dépens des autres marque le triomphe de la liberté individuelle, celle
du bon plaisir ; faudrait-il donc s’en réjouir ?
Non,
sûrement pas. Tout ce qui s’obtient aux dépens des autres est à éviter :
je suis l’autre pour des milliards de personnes sur la planète, il me faut donc
être avec les autres comme j’aimerais que les autres soient avec moi. C’est
l’éthique minimale en nos temps sans transcendance. Se savoir centre du monde
d’un point de vue ontologique en sachant que chacun se sait aussi pareillement
centre du monde et qu’il faut donc connecter en permanence ces centres pour
réaliser des réseaux éthiques et
produire de la morale en actes.
Peut-on
expliquer la fin du respect par la crise de l’autorité, le passage d’une
autorité légitime à la loi du plus fort qui, elle, n’est plus légitime ?
Mai 68 a
détruit avec bonheur une autorité de type théocratique qui avait fait son temps
— celle qui procédait de Saint Paul pour qui « tout pouvoir vient de
Dieu ». Mais les soixante-huitards n’ont pas créé l’autorité libertaire
alternative, contractuelle, qu’il aurait fallu proposer pour faire suite à ce
moment négateur. Nous vivons depuis, errants, dans ce vide ontologique,
métaphysique, donc éthique.
|
«
La fin de tout ce qui faisait communauté a laissé place au nihilisme d’une
époque où l’ar-gent fait la loi. »
|
Si faire preuve d’ incivilité, c’est nuire à
tous en ne respectant personne, dès lors comment encore vivre ensemble ?
L’homme
n’a jamais réussi qu’en coopérant ; la loi du chacun-pour-soi signe-t-elle
la fin de l’humanité ?
Il
y a les sauvages, les barbares, les égoïstes, les brutes qui sont seuls au
monde choisifient tout ceux qu’ils approchent et tous
ceux qui les approchent. Puis il y a des hédonistes, les altruistes, les
généreux, les prodigues qui veulent transformer en fête toute relation avec
autrui. Les premiers sont plus nombreux que les seconds, bien sûr. Et la
brutalité l’emporte toujours quand elle est en compétition avec la gentillesse
— qui est à mes yeux vertu cardinale et première.
Au final,
combattre l’ incivilité, n’est-ce pas résister à la
barbarie ?
Si,
absolument, et d’une façon éminem-ment concrète ■
PROPOS
RECUEILLIS PAR OLIVIA RECASENS
*********************************