Sections du site en Octobre 2009 : Ajouts successifs d’articles -- Sujets d’articles à traiter – Pour publier -- Post-Polio -- L'aide à domicile -- Internet et Handicap -- Informatique jusqu’à 100 ans – Etre en lien -- L’animal de compagnie -- Histoires de vie -- Donner sens à sa vie – A 85 ans aller de l’avant -- Tous chercheurs -- Liens –Le webmestre.
RETOUR A LA PAGE D’ACCUEIL : CLIC AUTEURS, TITRES
DE TOUS ARTICLES : CLIC SYNTHESE GENERALE: CLIC
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Janvier 2014
UNE AUTRE
PHILOSOPHIE DE LA PEINE
Anne CHEMIN
Le Monde samedi 9 novembre 2013
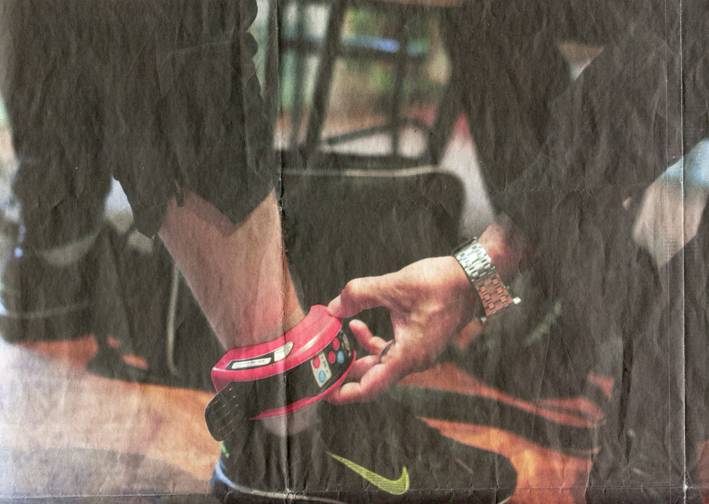
|
Le 11 octobre, pose d’un bracelet électronique au domicile d’un
jeune homme, |
Soins,
bracelet électronique, périmètres interdits, indemnisation de la victime :
la probation comporte de nombreuses contraintes, mais elle rompt avec la
tradition de l’incarcération. D’où son aspect controversé
°°°°°°°
Au premier rang des justifications de la
peine figure souvent un discours sur le devoir moral, voire sacré du châtiment.
Selon le philosophe Frédéric Gros, auteur d’un livre sur la peine, le premier
sens de cette peine est le « rappel à la loi » : la punition répond,par principe, à la
transgression d’un interdit. Cette dimension est à son apogée chez Kant, qui
refuse de faire entrer la peine dans le moindre calcul d’utilité : la
punition n’est pas destinée à dissuader le criminel ni même à susciter son
amendement, elle est simplement un « devoir moral absolu et catégorique »
destiné à réaffirmer la « majesté de la loi outragée ».
Cet impératif
est-il présent dans la probation ? À droite, beaucoup d’élus en
doutent : ils estiment que cette peine « cousue main » qui
s’effectue en liberté est un véritable cadeau fait au délinquants. « La
dimension punitive est pourtant présente dès le prononcé de la peine de
probation, rétorque le magistrat et essayiste Denis Salas, secrétaire général
de l’Association française pour l’histoire de la justice et directeur de la
revue trimestrielle Les cahiers dela justice. Le juge
dit : “Je vous déclare coupable et je vous condamne à une peine de probation.” Cet acte de
langage prononcé dans le cadre d’un tribunal symbolise la réprobation de la
société et réaffirme l’ordre social. La société parle, la loi est posée, la
peine est inscrite dans le casier judiciaire. Tous les éléments de la punition
sont là : l’audience, le juge, le rituel, le casier. »
Mais la
dimension punitive ne s’arrête pas aux symboles. Pour les défenseurs de la
probation, les obligations qui seront imposées aux condamnés n’ont rien d’une
faveur ou d’un bienfait. « Il y aura une effectivité réelle de la sanction,
souligne l’avocat et professeur de droit Jean Danet. Le
condamné devra, par exemple, porter un bracelet électronique, ne pas se rendre dans les lieux où il a ses
habitudes de vie, indemniser la victime, respecter une obligation de soins en
matière de toxicomanie ou d’alcool, toutes choses qui sont souvent très
difficiles à faire. » « Pendant sa peine, le condamné sera en liberté, mais il
sera constamment encadré et surveillé, renchérit la philosophe Myriam Revault d’Allonnes, membre du jury de la conférence de
consensus. Il ne s’agit pas de le mettre dans un jardin d’enfants. »
« Pendant sa peine,
le condamné
sera
en liberté, mais sera constamment encadré et surveillé. Il ne s’agit pas de le
mettre Dans
un jardin d’enfants » Myriam REVAULT D’ALLONNES
philosophe |
La magistrate Nicole Maestracci, présidente du comité d’organisation de la
conférence de consensus, insiste, elle aussi, sur le fait que la peine de
probation est une « peine à part entière ». Ce n’est toujours pas
évident à saisir car les murs de prison sont visibles, alors que les
obligations de la probation ne le sont pas, remarque-t-elle. Il faut cependant
sortir de l’idée que les peines en milieu ouvert sont plus douces que
l’enfermement. Pour beaucoup de délinquants, les contraintes imposées par la
peine de probation seront plus difficiles à supporter que la prison, un endroit
où certains détenus passent des journées entières en cellule à regarder la
télévision. La prison, c’est souvent la déresponsabilisation. »
Si la
dimension punitive n’est pas absente de la peine de probation, son inspiration
principale vient cependant d’ailleurs. « Cette peine s’inscrit complètement
dans la philosophie de la réhabilitation
», résume Denis Salas. Amendement, régénération, éducation,
réinsertion : les mots ont varié, mais, au XIXe siècle, l’idée
que le délinquant doit être éduqué finit par s’imposer. À l’époque, la
réhabilitation « se comprend comme re-moralisation
ou resocialisation, écrit le philosophe Frédéric Gros dans Et ce sera la
justice : punir en démocratie (Odile Jacob, 20014). Punir serait
réinjecter dans l’individu coupable des normes sociales ou morales. »
Depuis le XIXe
siècle, cette notion a évolué : il est nullement question, aujourd’hui, de
défendre une vision rédemptrice, voire salvatrice, de l’âme du condamné. Mais
si la dimension religieuse s’est éloignée, l’idée de la réhabilitation est
toujours très présente.La peine de
probation vise la restauration sociale, pas morale, précise Myriam Revault d’Allonnes. Il ne s’agit pas de transformer un
délinquant en un être vertueux en supprimant en lui toute envie de faire le
mal : la psychanalyse, avec Freud, nous a montré que l’on ne pouvait pas
éradiquer le désir du mal. La peine de probation cherche, plus simplement, à
rendre le condamné apte aux exigences de la vie sociale. Elle repose sur des
considérations politiques, pas sur des considérations morales. »
Nicole Maestracci, qui a, depuis la conférence de consensus, été
nommée membre du Conseil constitutionnel, rejette, elle aussi, les discours
moralisateurs : selon elle, la peine de probation ne vise pas à régénérer
intérieurement le condamné mais à lui permettre, plus modestement, de « mener
une vie compatible avec la société telle qu’elle est ». « Elle est fondée
sur une idée nouvelle, la “désistance”, c’est-à-dire
l’étude des raisons pour lesquelles les personnes sortent de leur parcours de
délinquance. En encadrant les condamnés, elle les aide à retrouver des points
d’appui : sortir de la toxicomanie ou de l’alcoolisme, trouver un
logement, renouer des liens familiaux, suivre une formation professionnelle ou
chercher un travail.C’est long car il est souvent
très difficile de changer de mode vie, mais le délit peut être l’occasion
d’amorcer ce virage. »
La dernière
source d’inspiration de la peine de probation vient du monde anglo-saxon :
c’est la philosophie de la « restorative justice
», une doctrine tellement éloignée de la mentalité française que sa
traduction est hésitante – les spécialistes parlent indifféremment de justice « restaurative », «
réparatrice » ou « restauratrice ». Apparue il y a une trentaine
d’années au Canada et aux Etats-Unis, elle cherche à retisser les liens sociaux
altérés par l’infraction. « Cette justice vise à assurer la resocialisation
de l’auteur de l’infraction et, in fine, le rétablissement de la paix sociale,
résume le Rapport de la conférence de consensus. Elle entend de ce fait
redistribuer les rôles entre l’Etat responsable du maintien de l’ordre et la
communauté civile. »
Conférences
de groupe en Nouvelle-Zélande, cercles de soutien et de responsabilité au
Canada, rencontres détenus-victimes en Belgique : la justice réparatrice
tente de faire naître des gestes ou des paroles de réconciliation. La peine de
probation ne va pas jusque-là mais elle est, elle aussi, attentive à la
réparation des liens sociaux. « Avec la probation, la société devientun acteur de la peine, souligne Denis Salas.
Ce n’est plus la société sondagière et vengeresse de
l’utopie sécuritaire et du populisme pénal, mais une société apaisée, qui
participe activement à la mise en œuvre de la sanction — une municipalité, par
exemple, qui organise
un stage de sécurité routière pour les délinquants de la route ou une
association qui met en place de groupes de paroles pour les auteurs de
violences conjugales. »
Si elle est
votée, que deviendra, au fil des ans, cette peine de probation qui emprunte à
des registres philosophiques si différents ? Nul ne peut encore le dire.
Car une peine se construit peu à peu, au travers des circulaires rédigées par
le ministre de la justice, de la jurisprudence délivrée par les tribunaux, des
pratiques des conseillers d’insertion et de probation, des réactions d’une
société conviée à participer à la mise en œuvre de la sanction. Le législateur
vote la loi mais ce texte n’épuise pas le sens de la peine, conclut Denis
Sarlat. L’histoire de la peine de probation, comme celle de toutes les
sanctions, sera le fruit d’une écriture collective. ■
Anne CHEMIN
« Aujourd'hui, le
concept majeur de la sécurité, ce n'est plus l'enfermement, c'est la
traçabilité »
|
|
Frédéric Gros est professeur
de philosophie éthique à l'université Paris-Est Créteil et chargé de cours à
l'Institut d'études politiques de Paris. Ce spécialiste de Michel Foucault a
publié en 2001, Et ce sera justice,
punir en démocratie (Odile Jacob). Il retrace ici l'histoire des châtiments
créés par les hommes et le sens qu'ils revêtaient aux yeux de leurs
contemporains.
«
Aujourd'hui, la prison est la peine de référence, au point que nous oublions
parfois est qu'elle est très récente ̶ elle est née au XIXe
siècle. Pendant très longtemps, les hommes ont imaginé d'autres châtiments et
ils en inventent encore. Ces peines relèvent de trois philosophies très
différentes.
Le premier
groupe rassemble les peines corporelles que l'on dit “d'Ancien Régime” ̶ les supplices, les coups de fouet, les
mutilations, les galères, les travaux forcés. Ces châtiments organisés comme
des spectacles tentaient d'inscrire dans le corps du condamné la loi bafouée et
d'impressionner l'imaginaire des hommes ̶ il s'agissait de frapper l'imagination pour
retenir le bras des criminels.
« Avec la
protection, ce n’est plus
la
société vengeresse de l’utopie sécuritaire mais une société apaisée, qui participe
activement à
la mise en œuvre de la sanction » Denis SALAS
magistrat |
Le deuxième
type de peine, c'est l'enfermement, qui, au XIXe siècle, est devenu
la modalité pénale majeure. Au départ, la prison a été conçue comme une décorporation : au nom de la lutte contre la barbarie,
on ne blessait plus le corps du condamné, on se contentait de le priver de
liberté. L'idée était d'obliger le détenu à un retour sur soi, une réflexion,
une pénitence ̶ le mot “cellule”
renvoie d'ailleurs à l'univers religieux. À cette fonction de régénération et
de correction, s'ajoutait une fonction de neutralisation : il fallait
éloigner les criminels.
Dans Surveiller
et punir. Naissance de la prison (1975), Michel Foucault voit dans la
prison la signature d'une société disciplinaire : si elle devient une
évidence, au cours du XIXe siècle, c'est parce que l'ensemble de la
société (les écoles, les hôpitaux, les casernes) fonctionne, dans cette
période-là, à la discipline.
Le troisième
groupe rassemble les peines en milieu ouvert. Elles sont très modernes, car
elles correspondent à nos sociétés de contrôle : aujourd'hui, le concept
majeur de la sécurité, ce n'est plus l'enfermement, c'est la traçabilité.
On laisse les gens circuler puisque, dans un monde globalisé, le mouvement est
censé créer de la richesse, mais on les accompagne, on les suit, on les évalue
sans cesse et on infléchit leur trajectoire quand elle commence à déraper. La
peine de probation appartient à ce modèle de gouvernementalité.
■
PROPOS RECUEILLIS PAR A.CH.

|
Station de métro Hyde
Park Corner, Londres, le 29 avril 2011. un délinquant condamné pour un délit
mineur nettoie ce mur en vue de la préparation du mariage royal de Kate
Middleton et du prince William. SANG TAN/AP |
Antoine Garapon :
« C'est une sanction néolibérale »
|
|
Antoine Garapon,
magistrat, est secrétaire général de l'Institut des hautes études sur la
justice. Membre du comité de rédaction de la revue Esprit, il a
notamment publié Le Gardien des promesses (Odile Jacob), 1996) et Les
nouvelles sorcières de Salem. Leçons d'Outreau (avec Denis Salas, Seuil,
2006).
Vous estimez
que la peine de probation sera difficile à acclimater en France.
Pourquoi ?
La première
difficulté, c'est que cette sanction est née d'une démarche pragmatique à
l'anglo-saxonne : son but n'est pas de faire la morale au condamné mais de
résoudre les obstacles concrets à son insertion sociale – l'alcoolisme, les
crises familiales, l'absence de logement, de travail ou de formation
professionnelle. La probation se résume finalement à une série de mesures de
sûreté supervisées par un juge. Pour un Français, cette conception de la peine
est difficile à admettre : la République française est une communauté
morale, la sanction doit impérativement avoir une dimension symbolique et rétributive.
La seconde difficulté, c’est que la peine de probation est mise en
œuvre en étroite collaboration avec la community,
mot qui désigne, pour les Anglo-Saxons, les associations,les voisins et les institutions locales. Il est
difficile de le retraduire en français, ce qui n'est pas un hasard : la
« community » correspond à une conception de la
sanction très différente de la nôtre. En France, la peine relève des pouvoirs
régaliens de l'État, elle renvoie à cette part de souveraineté et de majesté
qui rassure les citoyens en affirmant la prééminence de la loi.La
probation, avec sa dimension « communautaire », n'est pas facile à transposer
dans un pays où les corps intermédiaires sont fragiles et où l'imaginaire
symbolique tourne toujours autour de l'État.
Vous affirmez cependant qu'elle est très bien adaptée à notre
modernité. Pour quelles raisons ?
C'est une peine « néolibérale » au sens où elle repose sur l'idée de la
performance : elle dit au condamné que les ressources sont en lui et qu'il
peut être son propre agent de probation, faisant ainsi l'écho à l'idéologie
moderne du do it yourself.
C'est aussi une peine « ambulatoire », qui permet au condamné de rester en
liberté et donc de continuer à circuler : dans un univers mondialisé qui
valorise le mouvement et les échanges, le contrôle, y compris dans l'univers de
la peine, passe de moins en moins par l'immobilisation physique de personnes,
et donc par la prison.
Enfin, c'est une peine adossée à un système de calcul des risques très
répandu dans le monde contemporain : pour limiter la récidive, les juges
qui mettent en œuvre des peines de probation au Canada et en Angleterre
utilisent des tableaux statistiques fondés sur le profilage des délinquants,
comme le font les sociétés d'assurance. ■
PROPOS RECUEILLIS PAR A.CH.
À LIRE
« DEALS DE JUSTICE. LE MARCHÉ AMÉRICAIN DE LOBÉISSANCE MONDIALISÉE » d’Antoine Garapon et Pierre Servan-Schreiber (PUF, 200 p., 19€). « VERS UNE AUTRE POLITIQUE PÉNALE » de Denis Salas (revue Etudes, tome 419-4, 11€). « LA JUSTICE DÉVOYÉE. CRITIQUE DES UTOPIES SÉCURITAIRES » de Denis Sarlat (Arènes, 2012) « LA CRISE SANS FIN. ESSAI SUR L’EXPÉRIENCE MODERNE DU TEMPS » de Myriam Revault d’Allones (Seuil, 2012) « LA RÉPONSE PÉNALE, DIX ANS DE TRAITEMENT DES DÉLITS »
coordination de Jean Danet (Presses universitaires de Rennes, 542 p., 24€). |