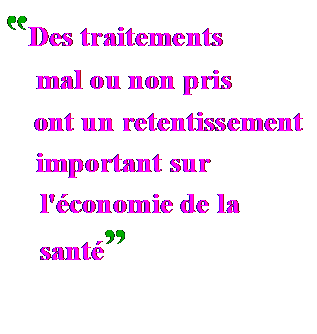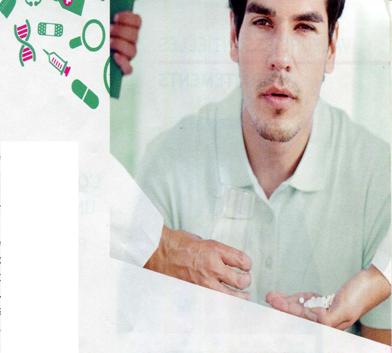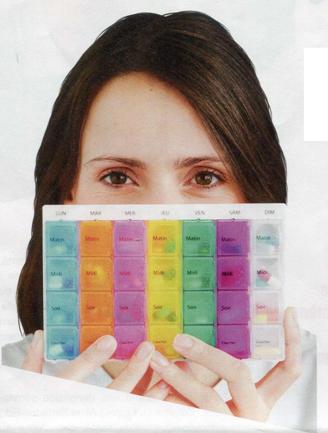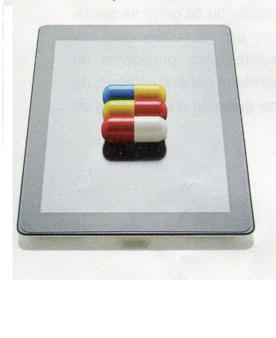Entrée sur site http://bien.vieillir.perso.neuf.fr
en Octobre 2015. Contacts henri.charcosset@neuf.fr
OBSERVANCE :
aider les patients À
SE PRENDRE EN MAIN ?
Séverine BOUNHOL
VALEURS MUTUALISTES, Septembre-Octobre 2015
Bien
suivre son traitement lorsque l’on souffre d’une maladie chronique :
simple affaire de volonté ou d’outils numériques ? Que nenni ! Les
solutions pour favoriser « l'observance thérapeutique » sont à
chercher ailleurs.

> L'inobservance
ou incapacité à respecter les prescriptions médicales dans les maladies
chroniques(1) préoccupent
autant les professionnels (médecins, pharmaciens…), les institutionnels
(ministères, assurance maladie, mutuelles…), les industriels que les patients
eux-mêmes. À juste titre. Car un traitement mal ou non pris fonctionne bien sûr
moins bien. Cela peut entraîner effets indésirables, néfastes voire mortels,
rechutes, escalade thérapeutique, hospitalisations, pharmaco-résistance… bref,
de lourdes conséquences humaines et financières. Or, seul 1 % de patients ne
ferait aucune erreur sur un mois de traitement : un chiffre avancé par
Jean-Luc Harousseau, président de la Haute autorité
de Santé (HAS), lors d’un colloque organisé par le Collectif interassociatif sur la santé (Ciss),
Coopération patients et [Im]patients, chroniques & associés, le 1er
juin dernier. D’où une volonté largement partagée de renforcer l’observance
thérapeutique.
|
|
|
Mais les pistes pour y parvenir
diffèrent selon les acteurs : les uns appréhendent ce sujet complexe
essentiellement sous un angle comptable ; les autres mettent l’accent sur
l’aspect et la relation de soins.
Des arrêtés ministériels controversés
Ce débat autour
de l’observance a été relancé l’hiver dernier avec l’annulation par le Conseil
d’État d’arrêtés pris en 2013 par les ministères de la Santé et du Budget. Pour
la première fois, la prise en charge d’une maladie était conditionnée par son télésuivi : en l’occurrence le traitement de l’apnée
du sommeil par pression positive continue (PPC).
Ce dispositif
était loué par un prestataire aux malades et son utilisation contrôlée par un
système électronique de transmission de données à distance. Si celle-ci ne
correspondait pas au seuil fixé, l’appareil n’était plus remboursé. De quoi
insurger les associations :elles y avaient vu une
volonté de fliquer et de pénaliser les patients. Selon Dominique Polton, conseillère auprès du directeur général de la
Caisse d’assurance maladie (Cnam), « ce n’est
pas tout à fait cela. […] La réalité est qu’on ne paye pas des prestataires qui
ne rendent pas le service. (…) Nous cherchons des moyens d’utiliser l’argent
public d’une façon plus efficace (…) ». Quoi qu’il en soit, les
inquiétudes soulevées demeurent car les arrêtés ont été annulés pour une raison
de forme et non de fond (défaut de base légale). Pas sûr que, demain, les
pouvoirs publics ne développent des systèmes similaires obligeant à « bien
se traiter » selon une norme standardisée.
Lors du colloque,
la ministre de la Santé, Marisol Touraine, s’est
voulu rassurante : « Il s’agit de favoriser l’observance, non de
la contraindre. » Elle a exprimé son « attachement » à
la liberté des malades, qui ont « le droit d’arrêter [leur] traitement,
quand bien même ce n’est pas recommandé ».(2)
|
ÊTRE
OBSERVANT, Réponse :
un ensemble de comportements. Cela englobe la prise des traitements
médicamenteux et régimes prescrits, mais aussi le fait de se rendre aux
rendez-vous des médecins, d’avoir une alimentation saine, de faire de
l’exercice physique, d’éviter de fumer… « En
droit de la protection sociale, l’observance est venue dans le jargon de
l’assurance maladie et des complémentaires santé du projet de gestion du
risque. |
|
|
Cela
consiste en un ensemble d’actions destinées à responsabiliser les acteurs de
santé − professionnels et patients −, de sorte à ce qu’ils
adoptent un comportement vertueux », explique Vincent Vioujas, chargé d’enseignement à la faculté de droit et
de sciences politiques d’Aix-en-Provence. |
|
|
‟L'observance thérapeutique est un phénomène complexe et insuffisamment étudié” |
Une question de mots
Le
problème prend une dimension sémantique. Comme l’a rappelé Aline Sarradon-Eck, anthropologue de la santé, chercheuse au
centre Norbert Elias, le terme « observance » vient de l’univers
religieux (= obéissance à une loi). Il est la traduction du mot anglais compliance, désignant un comportement de
santé en fonction d’une norme médicale. En Français, ce terme connote une idée
de soumission(3). Pour les
associations de patients, il sous-entend qu’il existe des « bons »
malades ‒ les « observants », ceux
qui font tout ce qu’on leur dit ‒ et des « mauvais » - les
« inobservants », ceux qui sont réticents.
Elles lui préfèrent le mot d’ « adhésion » qui reflète une
approbation réfléchie à prendre en charge sa maladie, en dépit des contraintes
assorties. Changer de terminologie reviendrait à prendre en compte la
subjectivité du rapport à la maladie et aux traitements. Rapport soumis à de
multiples facteurs fluctuant dans le temps : complexité, durée et
visibilité sociale de la maladie, effets secondaires des traitements, savoirs
transmis aux patients, événements de vie, traits de personnalité, environnement
social et culturel…
On
peut être observant le temps d’une hospitalisation et ne plus l’être une fois
sorti. Cesser son traitement le dimanche, le temps de ses vacances ou de gérer
sa sexualité. Etc. « Les patients ne sont pas non-observants
par plaisir », résume Danièle Desclerc-Dulac,
présidente du Ciss. Et Christian Saout,
son secrétaire général délégué, de surenchérir : « Ce n’est pas
une question d’envie mais de capacité à. »
|
|
L’OBSERVANCE,
UN PHÉNOMÈNE MESURABLE ? Pas
vraiment. Pour la mesurer, il existe des méthodes directes (dosages sanguins,
etc.) et indirectes (questionnaires, techniques de comptage des comprimés,
etc.). Mais elles ne tiennent pas compte, des différences métaboliques
individuelles. De plus, à partir de quel seuil estimer l’observance quand
celle-ci oscille dans la durée ? Oublier un traitement un jour n’est pas
pareil que l’oublier trois jours de suite ou que le prendre à demi-dose.
Bref, l’interprétation des études existantes est sujette à caution. |
|
‟L'observance renvoie à la conformité thérapeutique alors que l'adhésion évoque une approbation
réfléchie.” |
Les leviers de l’observance
Alors,
que faire ? Aboutir à une décision éclairée, consentie, partagée dans le
cadre de la relation patient-soignant. « Ce qui n’est pas toujours le
cas », reconnaît la ministre de la Santé. Quatorze ans après ans après
la loi Kouchner sur les droits des malades… Ces derniers réclament toujours et
encore davantage d’écoute, de respect, de tact, d'implication dans leurs traitements,
d'information, de pédagogie, d’accompagnement(4).
Autres leviers à actionner pour tendre vers une « alliance »
thérapeutique : des prescriptions pertinentes, des dispensations correctes
(cf. ruptures de stocks),des médicaments à prix
abordables et des restes à charge mieux couverts, des délais moins longs pour
prendre rendez-vous, etc. Sans oublier l’innovation thérapeutique (mise à
disposition de produits aux galénique et posologie adaptées) et technologique
(développement d’objets connectés tels des piluliers, des injecteurs, des
applications pour Smartphone…) Car, à l’heure du Big
data, « des algorithmes de décisions » et de l’ « automesure de soi » (« quantified-self »),
la technologie peut aider les patients à être véritablement acteurs de leur
choix de vie et de santé, plutôt que servir une médecine de la surveillance.
Séverine
Bounhol
(1) Diabète, asthme, psoriasis, épilepsie, sida, sclérose en
plaques, cancers, maladies cardiovasculaires, rénales…
(2) Elle a confié à l’Igas la mission
d’analyser ce sujet de la télésurveillance, dont une base législative pourrait
être introduite dans le cadre du Projet de loi de financement de la Sécurité
sociale (PLFSS) 2016 qu’examineront les députés du 20 au 27 octobre 2015.
(3) En mécanique, il désigne la capacité d’un métal à se laisser
distordre !
(4) Cf. la longue liste des recommandations émises par un panel
de 50 personnes concernant les enjeux de responsabilisation et d’autonomie dans
les soins, suite au colloque du 1er juin, sur ciss.org.
|
‟Des traitements mal ou non pris ont un retentissement important sur l'économie de la
santé” |
|
thérapeutique est un phénomène complexe et insuffisamment étudié” |
« IL
FAUT BÂTIR
LA RELATION DE SOINS
SUR LA CONFIANCE »
Philosophe et diabétique depuis l’âge de seize ans, Philippe Barrier* croit en la vertu de l’exemple. Son expérience de
malade chronique l’a conduit à forger le concept
d’ « auto-normativité » dans le cadre de ses travaux théoriques.
►Valeurs mutualistes : Selon vous, comment garantir
l’observance ?
Philippe
Barrier : Pour être
efficace et éthique, la relation de soins ne peut pas être une relation
d’obéissance. Les malades chroniques ne se soignent pas par soumission mais
parce qu’ils veulent se soigner, qu’ils en ont compris eux-mêmes la nécessité
interne.
V.M. : C’est en cela que vous parlez d’ « une
prise de conscience auto-normative » ?
P.B. :
Dans le vivant, il y a une force inhérente à lutter contre le pathologique, une
capacité à créer et à adapter les conditions de sa survie et de son
épanouissement. Chez les humains, cela se prolonge dans la conscience.
Conscience de leur capacité à comprendre leur norme de santé, les exigences de
leur traitement et les bienfaits que celui-ci leur procure. Comme une nécessité
interne. Ce, grâce à leur expérience propre et leur intuition de la maladie.
‟Ce n’est pas un dressage
comportemental
qui donnera des
effets positifs.” |
V.M. : Quelle solution face à l’inobservance, majoritaire
chez les malades chroniques ?
P.B. : Ce
n’est pas un dressage comportemental qui donnera des effets positifs. Il faut
renverser la relation de soins. Faire confiance à l’intuition des patients,
respecter leurs connaissances. Les médecins doivent prendre en compte les
exigences de vie des patients et celles du traitement, et trouver un compromis.
Trouver le juste équilibre pour que tout le monde soit gagnant.
Propos
recueillis par Séverine Bounhol
* Auteur de Le
patient autonome, éditions PUF, coll. « Questions de soin »,
2014.
|
|
Des expérimentations en préparation
En
juillet dernier, le secrétaire général délégué du Criss a remis à la ministre
de la Santé un rapport sur les expérimentations d’accompagnement à
l’autonomie, prévues dans le cadre du projet de modernisation du système de
santé (art. 22). Un sorte de cahier de charges, intitulé « Cap
santé », devant préparer les conditions opérationnelles de leur mise en
œuvre. Parmi ses propositions : avoir une approche non normative,
conduire ces actions « dans un territoire » : en visant un
public déterminé et en y associant des acteurs variés (associations,
collectivités locales, professionnels et établissements de santé,
chercheurs…), les évaluer dès le début. |