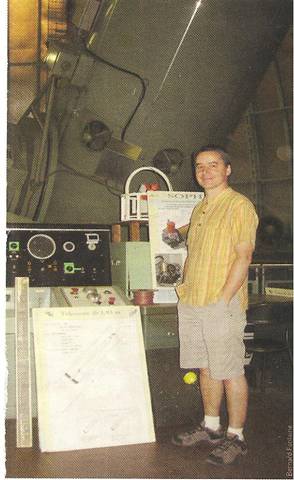Luc Arnold, ingénieur de recherche à l’OHB
CAES DU CNRS Le Magazine-103-2014
Article entré sur ce site http://bien.vieillir.perso.neuf.fr/
en Octobre 2015
«
À la recherche du vivant hors du système solaire »
La possibilité d'une forme de vie au-delà de la Terre a
toujours fasciné. Sur sa planète, le Petit Prince dialogue avec sa Rose. Les ouvrages
et les films de science-fiction ont peuplé notre enfance. La découverte récente
de planètes extrasolaires pose sur un plan scientifique la question de
l'existence d'une forme de vie « ailleurs », d'où
l'apparition d'une nouvelle discipline : l'exobiologie. Luc Arnold,
astronome spécialisé en exobiologie à l'Observatoire de Haute-Provence, évoque
ses activités.
Quel est
votre parcours scientifique ?
Luc
Arnold : J'ai été, dès l'enfance, attiré par les sciences
et plus particulièrement par l'astronomie. À 14 ans, je possédais déjà un
télescope. J'ai toujours été très intéressé par l'expérimentation. En 1995,
j'ai soutenu une thèse de doctorat sur l'optimisation des miroirs actifs et
adaptatifs pour les télescopes. Depuis janvier 1997, je suis ingénieur de
recherche CNRS à l'Observatoire de Haute-Provence (OHP).
Comment vous
êtes-vous dirigé vers l'exobiologie ?
En vérité, j'ai eu de la chance. Le facteur déclenchant a été la découverte, le 6 octobre 1995, soit un mois avant mon arrivée à l'OHP, de la première exoplanète en orbite autour d'une étoile de type solaire, 51 Pegasi b par Michel Mayor et Didier Queloz de l'Observatoire de Genève. Cette découverte a été faite au moyen du grand télescope de 1,93 m de l'OHP. Située dans la constellation de Pégase, l'étoile hôte dénommée 51 Pegasi est distante d'environ 51 années-lumière de la Terre. L'effervescence au laboratoire durant cette période extraordinaire m'a décidé à m'investir dans la recherche des exoplanètes et l'exobiologie, la recherche de vie extraterrestre, c'est-à-dire simplement, en dehors de la Terre. Ce domaine de recherche pluridisciplinaire a évidemment connu un formidable essor avec la découverte – tant attendue – des exoplanètes.
En quoi
consiste votre travail ?
Il est essentiellement observationnel. Je fais partie d'un consortium d'observateurs qui disposent de temps d'observation sur le grand télescope de l'OHP pour la recherche des exoplanètes. J'ai la chance d'avoir une grande autonomie dans mes recherches. J'ai aussi accès aux grands télescopes européens installés au Chili, en me déplaçant ou en utilisant les services d'un astronome sur place. Nous travaillons beaucoup à distance grâce aux moyens de communication à très haut débit de l'OHP.
Quelles
observations réalisez-vous avec son télescope de 1,93 m ?
De moyenne puissance optique comparé aux très grands instruments actuels, il a été pendant longtemps le plus grand télescope d'Europe. Mis en service [optique et mécanique] en 1958 avec un miroir fondu en 1934, il est déjà ancien, mais encore très utile pour des recherches sur des thèmes spécifiques – des niches scientifiques. Et surtout, il est équipé de moyens de détection très modernes et performants, notamment en spectrographe à haute résolution SOPHIE, ce qui en fait l'un des télescopes les plus performants au monde pour la détection des exoplanètes.
Avec qui
travaillez-vous ?
Dans le domaine de l'astrophysique et de l'exobiologie, la communauté scientifique internationale coopère étroitement. Pour mon dernier projet, j'ai travaillé avec des collègues français, suisses, chiliens, canadiens et allemands, spécialistes des exoplanètes ou des techniques d'observation et d'analyse des données. En exobiologie, on travaille aussi bien avec des astronomes que des biologistes ou des paléoclimatologues par exemple !
Quels signes
recherchez-vous en exobiologie ?
Les exoplanètes
étant très lointaines, il n'est pas question, au moins avant les 30 ou
50 prochaines années, d'en faire des images et d'y discerner des nuages, des
continents ou des océans. Au mieux, et nous y arrivons déjà pour certaines,
nous les verrons comme de simples points. On envisage donc de faire une
détection indirecte de la vie sur ces planètes. La technique utilisée est la
spectroscopie à basse ou haute résolution selon l'objet de l'étude. La Terre
étant la seule planète portant la vie connue aujourd'hui, on l'observe comme si
c'était une exoplanète en vue de préparer les
observations futures.
Comment
observez-vous la Terre comme une exoplanète ?
J'observe par exemple le reflet de la Terre sur la Lune, la lumière cendrée. Cette lumière solaire, qui s'est réfléchie sur la Terre avant de se refléter sur la Lune, a emporté avec elle la signature des éléments chimiques de l'atmosphère terrestre, l'oxygène, l'ozone, la vapeur d'eau... De la même manière, une exoplanète, qui est éclairée par son soleil et qui réfléchit une partie de cette lumière, nous envoie une lumière contenant des informations sur la composition de son atmosphère. Ces observations de la Terre nous permettent de nous préparer à ce que pourront être les signatures de la vie [biosignatures] sur les exoplanètes [cf encadré].
Pouvez-vous
évoquer un moment particulièrement excitant de vos recherches ?
À chaud, il me vient à l'esprit de la découverte, en 2012, d'une exoplanète, dont l'étoile hôte se nomme HD 159243. J'ai pu l'observer pour la première fois et commencer sa caractérisation trois nuits d'affilée. Quelques semaines plus tard, j'ai montré qu'il s'agissait de deux exoplanètes de type jovien [géantes gazeuses de masse voisine de celle de Jupiter] en rotation autour de la même étoile. Même si j'ai eu la chance de la détecter en premier, c'est, avant tout, le résultat d'un travail de groupe. Il a fallu sélectionner les étoiles à observer, poursuivre les observations, faire des analyses... Vous pouvez imaginer l'excitation de l'équipe à ce moment-là !
D'autres
souvenirs mémorables ?
L'accès à du temps
d'observation sur le Very Large Telescope
(VLT) de l'Observatoire européen austral a été un moment exceptionnel. La
concurrence est très forte pour utiliser ce télescope de 8 m situé au sommet du
Cerro Paranal au
Chili : une demande sur cinq ou six est retenue par le comité des
programmes.
Êtes-vous
impliqué dans la diffusion de l'information scientifique ?
Oui, c'est une partie
intégrante de notre mission de chercheur ou d'ingénieur. Je suis convaincu
depuis longtemps que les chercheurs ne peuvent plus rester isolés dans leur
labo. Nous devons au contraire nous ouvrir vers l'extérieur : écoliers,
lycéens et grand public. Nous ne faisons pas de recherches que pour nous, mais
pour tous ! Je participe à des conférences publiques sur l'exobiologie et
à des rencontres dans les écoles ou les lycées. La question de la vie extraterrestre
intéresse le public en général : il faut en profiter pour donner envie aux
jeunes de faire de la science ! Je m'implique activement dans les actions
du Centre d'astronomie de Saint-Michel l'Observatoire, qui accueille toute
l'année un public scolaire et adulte.
Les enfants
et les adolescents s'intéressent-ils à vos recherches ?
Ils se montrent pleins de curiosité pour l'astronomie et
j'ai toujours beaucoup de plaisir à me prêter au jeu de leurs questions. Ils me
demandent souvent si les extraterrestres existent. Bien sûr, je leur précise
que personne n'a de réponse à cette question aujourd'hui, et que l'on ne sait
encore rien de la probabilité de la vie ailleurs dans l'univers. Mais on
cherche ! Et l'on accumule les arguments pour et contre en vue de pouvoir
répondre un jour à cette question si importante de l'existence de la vie sur
les autres planètes. Je les informe par exemple de la découverte récente de
plus d'un millier d'exoplanètes dans la voie lactée ─
notre univers proche. Parmi elles, certaines sont pierreuses et situées à une
distance de leur étoile permettant la présence d'eau liquide et d'une
atmosphère. Portent-elles la vie ? On ne le sait pas aujourd'hui, mais
elles constituent des candidates de choix. Enfin, j'essaye d'amener le public,
et les jeunes en particulier, à porter un regard critique sur ces questions, de
les sensibiliser à la différence entre la pensée rationnelle du scientifique et
une pensée fondée sur la croyance en des dogmes existants.
Propos recueillis par Bernard Fontaine
|
Exoplanètes : y-a-t-il une vie ailleurs ? La présence d'autres planètes situées
hors du système solaire où la vie où la vie pourrait exister a depuis
toujours été une question philosophique et un but de recherche pour les scientifiques.
Distante de nombreuses années-lumière et masquée par la luminosité de
l'étoile autour de laquelle elle gravite, une exoplanète
peut-être détectée principalement grâce à deux méthodes : ─ la variation
dans le temps et la fréquence de la lumière émise par l'étoile, variation
créée par la masse de la planète [décalage de fréquence Doppler] ; ─ a diminution de l'intensité de la lumière émise par l'étoile due à une occultation très partielle de celle-ci par la planète. 1 783 exoplanètes ont été recensées à la date du 19 avril 2014. les spécialistes estiment qu'il existe 100 milliards de planètes dans la voie lactée. Les recherches se focalisent actuellement sur la détection de planètes semblables à la Terre où la vie pourrait exister. En 2009, le télescope spatial européen Corot a déjà détecté une telle planète (Corot 7 b). Le 17 avril 2014, le télescope spatial kepler de la NASA a identifié Kepler 186f dans la « zone habitable » de son étoile. La prochaine étape consiste à repérer la signature de la vie sur des exoplanètes (exovie), c'est-à-dire des signaux optiques (absorption de la lumière émise par l'étoile hôte) liés à des molécules biologiques (biosignatures). Cette science qui vient de naître est appelée exobiologie et de tels signaux ont déjà été observés ─ ce qui ne signifie pas nécessairement l'existence d'une forme de vie. Dans le futur, il est prévu d'utiliser des observatoires astronomiques placés dans l'espace tels le Terrestrial Planet Finder de la NASA et le Darwin de l'Agence spatiale européenne. |