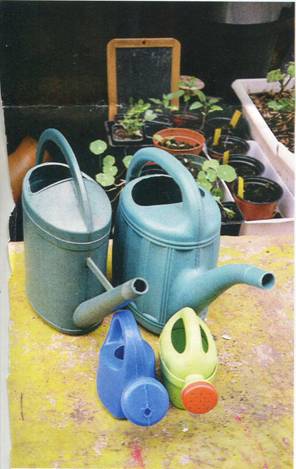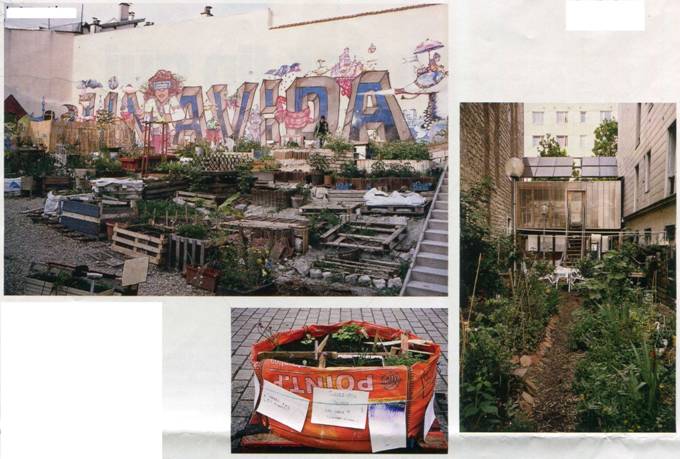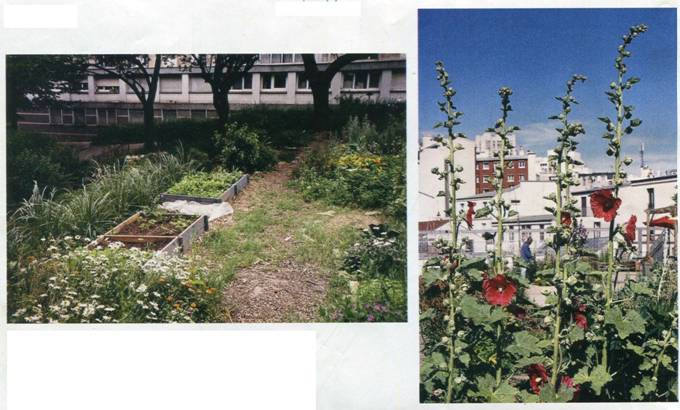Sections du site en Octobre 2009 : Ajouts successifs d’articles -- Sujets d’articles à traiter – Pour publier -- Post-Polio -- L'aide à domicile -- Internet et Handicap -- Informatique jusqu’à 100 ans – Etre en lien -- L’animal de compagnie -- Histoires de vie -- Donner sens à sa vie – A 85 ans aller de l’avant -- Tous chercheurs -- Liens –Le webmestre.
RETOUR A LA PAGE D’ACCUEIL : CLIC AUTEURS, TITRES
DE TOUS ARTICLES : CLIC SYNTHESE GENERALE: CLIC
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Juillet
2015
UN JARDIN
QUI VOUS VEUT DU
BIEN
Par
Guillemette FAURE/Photos Bertrand Le Pluard
Le Magazine du Monde, 14 juin
2014
Des
potagers plantés dans des sacs, des fraises cultivées sur un toit d’immeuble,
des parcelles “végétalisées”…
Attention
chantier ! Quand les urbains se mettent à biner, le vert n’a qu’à bien se
tenir. Car il doit survivre au bitume, aux bitures, et à ceux qui font du
jardinage le remède à tous les maux de la ville.
Par Guillemette Faure/Photos Bertrand Le Pluard
|
|
C’EST
JOUR DE MARCHÉ place de la Réunion
à Paris, dans le 20e arrondissement. Au bout de la rue Vitruve,
une grande brune en jean apostrophe les passants. « On installe un
potager, vous venez nous aider ? » Le fait qu’on soit dans une
rue piétonne et qu’il n’y ait ni terre, ni fruits, ni légumes n’aide pas à
être pris au sérieux. Les palettes sur lesquelles Nadine Lahoud
pose de grands sacs de terreau ne correspondent peut-être pas à la définition
d’un potager pour qui connaît la vie avec jardin. Mais entre la place de la
Réunion et la rue des Pyrénées, pourquoi pas ? « Dans
huit jours, c’est plus là… », grince
une grosse dame en passant. La dernière fois qu’on a parlé d’arbres dans le
quartier, c’est parce qu’ils avaient été plantés à travers les vitres des
voitures en stationnement. Des jeunes les avaient arrachés des jardinières,
s’étaient battus avec, et ils avaient fini en boutures végétalo-automobiles.
|
Déjà, en octobre 2013,
des représentants du quartier avaient pris rendez-vous avec la maire du 20e
et des commissaires de police divisionnaires. Dans le compte-rendu de leur
réunion, on apprenait que « des arbres ont été plantés pour éviter les
rodéos » en scooter, et les cailloux en pierre de volcan ont été
retirés des bacs à fleurs car ils servaient à caillasser
les voitures ». Avec une pareille interprétation des décorations végétales,on comprend que les riverains ne montrent pas
plus d’enthousiasme à l’idée de planter des radis sur des palettes. « C’est pas parce qu’on est de gauche qu’il faut se voiler la
face, continue la dame, qui égrène les dégradations du quartier. Pour
pas qu’ils y touchent,
ils devraient planter du shit. » « Je viendrai le récolter », répond
Nadine dans un éclat de rire prometteur.
Impliquée
dans plusieurs projets verts du quartier à travers son association Veni Verdi, Nadine Lahoud est
connue pour ses manières parfois déroutantes. Elle a déjà apostrophé un homme
d’un « monsieur, vous avez 82 ans, vous allez mourir dans deux ans,
qu’est-ce que vous les faites chier, les jeunes ? ». Une
invective qui n’a pas empêché l’octogénaire de rallier les projets de jardinage
urbain de Nadine. La proviseure du collège devant lequel les sacs sont
installés la connaît bien. « Nadine, on lui donne ça, elle prend
ça », blague-t-elle. Le premier « ça », c’était un élevage
de phasmes en classe. Puis 140 sacs cultivés et quatre ruches hyper productives
installés sur le toit de l’établissement. Et maintenant, les quatre gros sacs
de chantier alignés devant le collège, et dans lesquels des gamins
tripatouillent.
|
|
|
|
Dans une rue piétonne (ci-contre), de
gros sacs de chantier font office de jardinières où chacun est invité à
planter ce qu’il veut. « Dans huit jours, c’est plus
là ! », lance une passante amère. |
Malgré les incivilités, les initiatives de micro-jardin se
multiplient dans le 20e. Ci-dessus, le jardin partagé de la cité
Aubry ; à droite, le 56, parcelle cultivée par les habitants du quartier
Saint-Blaise. |
DANS L’ALBUM
D’ASTÉRIX Le Domaine des dieux, il suffit de jeter des glands trempés dans la potion
magique pour que des arbres jaillissent des trous. A voir ces petits citadins
semer des graines en les regardant pousser, il y a un peu de ça. Une mère
laisse quelques euros à son fils pour aller chercher des fleurs à planter chez
le fleuriste voisin. L’enfant revient avec un bouquet de fleurs coupées,
roulées dans leur cornet, qu’il compte piquer tel quel dans le sol. En ville,
la nature peut être très loin. « Je ne savais pas que les frites poussaient
comme ça », a déjà dit un môme à Nadine qui cueillait des haricots
jaunes. Enzo, Pablo, Armand… Ils ont entre 5 et 15 ans et viennent des écoles
voisines. « Non, pas toutes les graines d’un coup ! Un trou, une
graine, un trou, une graine… » Les petites mains s’arrêtent. « Sinon,
les radis, ils vont pousser comme ça », montre-t-elle en se
tortillant.
« Je me disais
qu’on pourrait mettre des géraniums, là… » C’est la râleuse de tout à l’heure qui est revenue
avec des idées pour les bacs dont les arbres ont été arrachés.
Le petit groupe s’est étoffé. « Ça rappelle la province », dit
Mireille qui est arrivée il y a quelques années de Saint-Étienne. Évidemment,
ses souvenirs de jardin à la campagne ne ressemblent pas à des sacs de chantier
dans lesquels les semis de courges, de haricots et de radis sont séparés par
des bouts de cagettes. Voilà l’adjointe au maire, Florence de Massol. Pour les bacs de la direction des espaces verts,
elle a baissé les bras. « On a replanté quinze fois… Les plantes ont
été saccagées, brûlées… Quand le matériel arrive tout cuit avec des gens
portant l’uniforme de la Ville de Paris, l’appropriation ne fonctionne
pas. » Mais elle a donné son aval (et la terre) pour les sacs.
Le 20e
arrondissement compte 23 jardins collectifs, dont 18 partagés. Devant le 56 rue
des Pyrénées, deux minis-jardins ont été plantés au pied des arbres ‒
« végétalisés » dit-on dans le vocabulaire
du jardin urbain. Là encore, avec l’aval d’une mairie soulagée de « lutter
contre les encombrants ». Des fleurs sauvages plutôt qu’une carcasse de
télé au milieu du trottoir. A chaque fois, l’adjointe au maire pousse à mettre
des petits panneaux « Ici, on jardine ». « Les gens ont plus
de respect quand ça vient de leurs voisins. »
Mais
peut-on vraiment lutter contre les incivilités à coup de plants de
tomates ? Il y a un côté musique classique à la façon dont on pare le
jardinage de toutes les vertus. La plante qui pousse dans le béton convoque une
innocence originelle, refuge contre les maux de la modernité. Comme si on
attendait des parcelles de terre en ville le même miracle que du piano en
libre-service à la gare aux heures de pointe. Enzo finit de planter des tuteurs
dans les sacs. « J’espère qu’on ne va pas me les piquer. »
« On va peut-être tout nous piquer », avertit Nadine. La
boulangère leur donne « une journée ». L’adjointe au
maire nuance : « Le premier mois, vous risquez d’avoir des
mauvaises surprises. Ensuite, ça se tasse. »
Enfin,
pas tout à fait. « Faudra faire attention en sortant, y a du
vomi… » C’est Françoise Spuhler qui dit ça,
à 300 mètres de là, après le café du matin pris dans des verres au Jardin sur
le toit, 600 m2 de verdure posés au dernier étage d’un grand
bâtiment de la rue des Haies. Il y a une quinzaine d’années, un squat avec
jardin communautaire était installé là. Quand un gymnase a été construit à la
place, il a été décidé que le toit serait occupé par un jardin collectif. Le
Jardin sur le toit a tellement de succès que des jeunes y viennent parfois la
nuit, laissant au mieux des cadavres de bouteilles, au pire ce que Françoise
vient de découvrir ce matin.
Les mardis et jeudis
matin, Françoise, animatrice pour l’association Arfog
Lafayette, coordonne des ateliers de jardinage pour les personnes en
difficulté. « Planter tomates, Courges, Basilic », disent les
mots inscrits sur un tableau derrière elle. Le jardin « en lasagnes » (une alternance de
couches de compost, de branches, de cartons et de terre) est partagé entre le
jardin de réinsertion coordonné par Françoise, les parcelles des riverains
‒ le Jardin perché, géré par une association de voisins du quartier, dont
Nadine ‒ et une partie pédagogique en association avec une école de la
rue des Pyrénées. Le premier ‒ le plus spectaculaire ‒, coloré de
roses trémières, parfumé de thym et de lavandes, déborde de framboises, de
fraises et de cassis.
|
|
|
« Je ne savais pas que les frites
poussaient comme ça », lance un enfant en observant la cueillette de haricots jaunes.
Les écoliers sont associés à ces initiatives vertes, comme au jardin Python-Duvernois (ci-dessus). Les adultes, eux, ne mesurent pas
toujours la somme de travail qu’exige un jardin. « Je reviendrai au
printemps », a affirmé une cadre venue au Jardin sur le toit (à
droite) en octobre. |
|
|
A CHAQUE RENTRÉE, LE JARDIN perché compte de nouveaux inscrits qui se mettent au
jardinage comme ils se sont mis aux cupcakes deux ans
plus tôt. Mais le jardinage ‒ contrairement à la cuisine ‒ n’est
pas le domaine de la gratification immédiate. « Les résultats ne sont
pas forcément au rendez-vous », résume Françoise. « La grêle,
la sécheresse peuvent réduire à néant des heures de travail ». Et ceux
qui pensaient décompresser après le boulot découvrent aussi les flots d’e-mails
sur les calendriers de permanences, les inventaires des graines et autres
tableaux d’actions prévues (le jardinier urbain parle
d’ « action » là où l’homme des champs dit
« désherbage »). Rien d’inhabituel à entendre une cadre lâcher en
octobre : « Bon, moi, je reviendrai au printemps. »
« Vous avez vu, là ? » Cheveux gris courts et bottes en
caoutchouc jusqu’aux genoux, Odette montre les fleurs d’artichaut : « C’est
le baisodrome des coccinelles ! » Un jour, Odette est passée sur
le toit et a demandé à acheter des légumes. « Faut venir
travailler », a répondu Françoise. C’était il y a quatre ans. Depuis,
elle est là tous les mardis matin.
|
|
FAIRE
COEXISTER LES VOCATIONS HORTICOLES ET SCOLAIRES du jardin n’est pas toujours simple. Dans ce lieu,
comme avec les autres projets de Nadine, le retour à la nature est paré de
toutes les vertus. Bon pour la vie de quartier. Bon pour lutter contre la
délinquance. Bon pour la réinsertion. Mais mettez des voisins tout feu tout
flemme, des retraités, des jeunes, des marginaux… autour d’un potager, et vous
n’obtiendrez pas forcément la paix. « Vous voulez arroser où,
Philippe ? ‒ Peu importe. » Philippe appartient à un
groupe de patients suivis en psychiatrie à l’hôpital de la Croix-Saint-Simon.
Parmi eux, Édouard, en bermuda, interné depuis quatre ans, pilier du jardin.
Olivier, l’ergothérapeute, n’aimerait rien tant que de disposer de son propre
espace. Philippe s’est glissé une fleur derrière l’oreille. « Quand je
rentrerai chez moi, je continuerai à venir ici. Je viendrai en rollers. » Là,
Françoise vient de trouver un patient en train de savonner un arrosoir. « On
est dans un jardin d’associations qui accepte tout le monde mais je ne suis pas
d’accord pour qu’on les laisse seuls. » La matinée vire à l’amer,
après une scène où des outils ont été trouvés dans un lavabo et où chacun se
renvoie la faute. Heureusement, Odette rapporte la cueillette d’oignons blancs.
« L’oignon fait la force », blague Chabane,
un quinquagénaire mélancolique qui s’exprime par jeux de mots.
C’est
tout le paradoxe des jardins partagés. S’ils sont vraiment participatifs, comme
la partie autogérée du Jardin perché, le résultat peut être aussi foutraque que
les sacs de Nadine où des pancartes invitent chacun à planter ce qu’il veut.
Pour produire d’aussi belles framboises, d’aussi beaux cassis qu’au Jardin sur
le toit, il faut la main de fer de Françoise, Géraldine, une jeune femme qui
vient régulièrement, ramasse les fraises. « Ramasse pas tout », lui
crie Françoise, Géraldine continue. Elle est sourde. On récolte les fraises. « Pour
être aux fraises », blague Chabane. Olivier
présente deux paquets de plants à un de ses patients. « Comment reconnaîs-tu les concombres des courgettes ? »
« Les courgettes c’est grand comme ça et les concombres comme ça », répond
son patient, qui n’a que des feuilles sous les yeux. A côté, on désherbe une
parcelle. Chabane cherche « la bêche à
miel ». Distrait, Philippe jette son gant par terre et fourre les mauvaises
herbes dans sa poche. Plusieurs sont allés s’asseoir pour manger des fraises. « Aux
fraises de la princesse », dit Chabanne.
Il n’est pas toujours
actif, mais il est content d’être là. En ville, explique-t-il, l’inhumanité se
situe au niveau de la rue. « Là, c’est comme si on était monté d’un
cran. On n’est plus vraiment sur terre… Ça m’apporte
rien, ça me déporte. » Comme si ce jardin ramassait, à douze mètres du
sol, toutes les herbes sauvages dont la ville ne sait pas quoi faire.
Accroupies, Esther et Tania parlent un peu du dernier week-end, de leurs
filles, de la place à laisser entre les plants. Ces échanges à gratter la
terre, côte à côte, ont l’intimité des onversations
de voiture quand on roule la nuit sans se regarder. « Il y a trop de soucis
là… » « C’est sûr qu’on a trop de soucis. »
Dans
un même périmètre, différents projets placent différemment le curseur entre
impact social et considérations écologiques. « Non, pas comme ça… Les
courgettes, ça pousse en prenant de la place… » Françoise râle. Mais
elle, Nadine et leurs coreligionnaires ont en commun de croire que « quand
on met de la terre, on pense à l’avenir ». Dans les grands sacs de la
rue Vitruve, les pancartes des enfants ont été lavées par la pluie. Un soir,
alors que deux jeunes passent, l’un s’élance pour filer un coup dans les sacs. « Hé !
C’est de la nourriture, ça se respecte », le reprend son copain.
Huit
jours après l’installation des potagers, les pommes de terre ont disparu, un
plant de tomates a été cassé. Des petites feuilles sortent de terre. Une dame
reconnaît les pousses de radis. En fin d’après-midi, voilà Nadine qui descend
de son opération jardinage sur le toit du collège avec des feuilles de salade
dans son sac. « Vous voulez goûter ? » Le groupe de
jeunes qui traîne devant la porte s’exécute avec le plaisir de la
transgression. Une retraitée s’arrête devant le bac. « Les tomates qui
vont pousser, elles ne vont pas rester là longtemps… » A côté, une
première fleur de capucine vient de s’ouvrir. M

Le 20e arrondissement de Paris
compte 23 jardins collectifs, dont 18 partagés. Posé au dernier étage d’un
gymnase de la rue des Haies, le Jardin sur le toit accueille riverains,
écoliers et personnes en réinsertion.