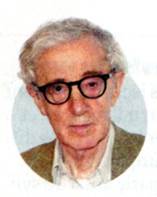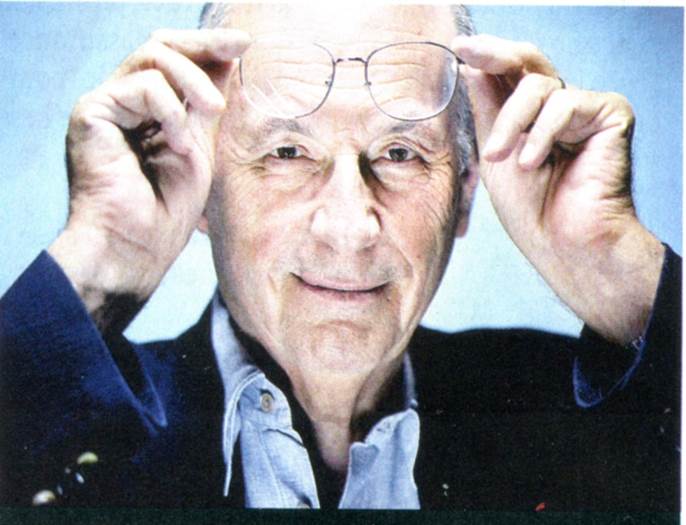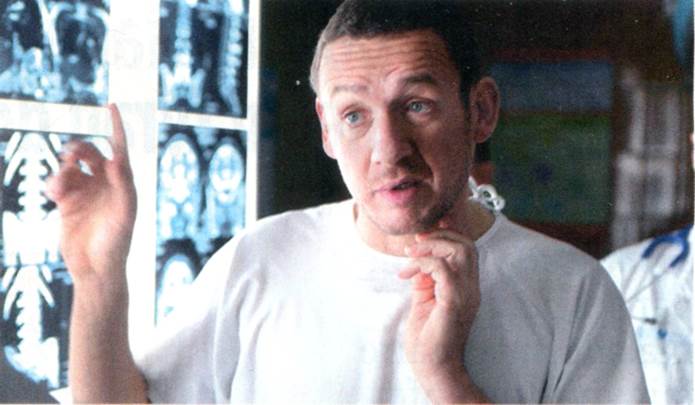Article
entré sur site en mars 2016
HYPOCONDRIAQUES,
LE (VRAI) MAL DU SIECLE
Le POINT, Février 2014
Le top 5 des sites santé
|
|
|
|
Nombre de visiteurs uniques en novembre 2013,
en milliers
Part des internautes en
France
|
Santé-médecine.net |
4 025 |
8,7 % |
|
|
|
|
|
|
|
Le Figaro santé |
1 308 |
2,8 % |
|
|
|
|
|
|
Topsanté
|
1 266 |
2,7 % |
|
|
|
|
|
|
|
Medisite.fr/Planet.fr |
1 214 |
2,6 % |
|
|
|
|
|
|
|
Eurekasanté/Vidal |
1 114 |
2,4 % |
|
Sources :
Mediametrie/NetRatings/Nielsen.
Phénomène. Un nombre croissant de Français sont sujets à
l’hypocondrie. C’est grave, docteur ?
PAR JULIE
MALAURE
|
|
Ce matin, Frédéric, 39 ans, dirigeant d’une
petite PME à Roissy, se lève avec la certitude que quelque chose ne va pas. Une
douleur brutale, dans l’occiput, comme la veille.
Là où chacun se contenterait d’un comprimé
d’aspirine pour que ça passe, Frédéric, lui, envisage le pire. Il se masse la
nuque, ressent une raideur, fixe l’ampoule du plafonnier, mais une sensation
désagréable, comme un flash, le force à détourner le regard. Cette fois, il en
est sûr, il s’agit d’une méningite. Et au ressenti de ces deux symptômes, qu’il
connaît par cœur, son pouls s’accélère ; le voilà pris de vertiges, de
bouffées de chaleur, dus, sans doute, à la fièvre qui va immanquablement
s’installer. Frédéric se passe mentalement le film de sa mort, imminente,
foudroyante, et ce matin encore il va devoir faire des efforts draconiens pour
prendre du recul, résister à l’envie de courir aux urgences, incapable de se
concentrer au travail tant qu’il n’aura pas eu, au moins, son généraliste en
ligne.
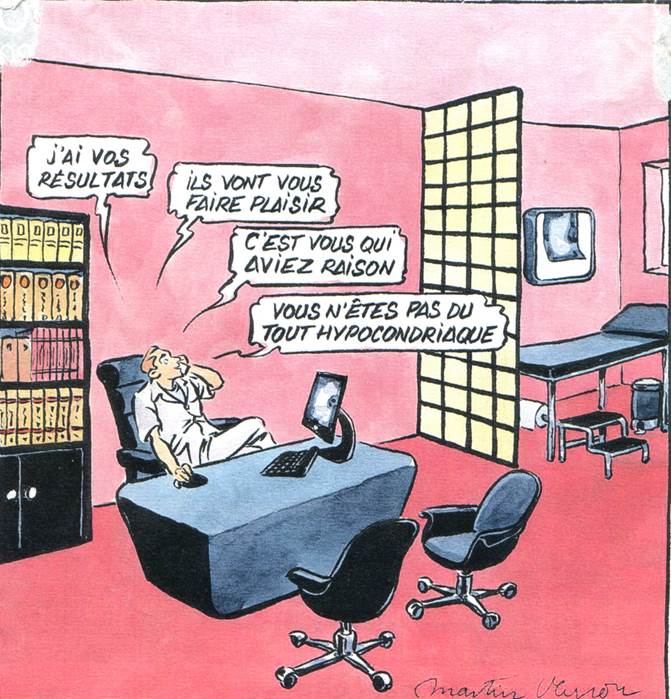
Frédéric, comme 2 à 4 % de la population
française, selon les estimations, souffre d’hypocondrie, un trouble de nature
anxieuse, une préoccupation centrée sur la crainte ou l’idée d’être atteint
d’une maladie grave.
Tuberculose,
leucémies, troubles cardio-vasculaires, scléroses en plaques et cancers : la
liste des maladies qui obsèdent ces Argan en puissance, comme dans la pièce de
Molière, est interminable. Adeptes du scanner, ils rêvent d’IRM, se damnent
pour une scintigraphie. Abonnés aux urgences, exégètes de la posologie
médicamenteuse,ils consultent à outrance, sans paradoxalement pouvoir faire
confiance aux médecins. Ultra-angoissés à l’idée d’être malades et dans
l’impossibilité de s’imaginer ne pas l’être, les hypocondriaques écoutent leurs
organes, examinent leur corps en permanence. Frédéric raconte les heures
passées à la recherche d’un ganglion, à se palper, se scruter, jusqu’à
découvrir un bouton « inquiétant », une langue « trop blanche ». Il
avoue sa terreur parce qu’il en est à sa seconde angine blanche de l’hiver («
ce qui pourrait cacher un début de glomérulonéphrite »), ne touche plus sa
femme depuis que sa masseuse l’a griffé par inadvertance (« et si j’avais le
sida ? »), masseuse dont le prénom lui échappe (« c’est sûrement un
début d’Alzheihmer »). Pis, la semaine dernière, son bilan sanguin lui
révélait un mal incurable : « Mes résultats montrent un déficit en LDH,
le lactate déshydrogénase bas. Or, associé à des myalgies, des douleurs
musculaires, il y a une possibilité de glycogénase musculaire qui, découverte à
l’âge adulte, peut dégénérer plus ou
moins vite dans un tableau de myopathie. » Un vrai Vidal ambulant ! ■ ■ ■
|
|
|||||
|
||||||
|
|
|
|||||
L’avis
du psy
«
Molière est notre meilleur psychiatre et le plus grand hypocondriaque du
monde. Avec “Le malade imaginaire”, tout est dit. » |
■ ■ ■ Cette obsession le
pousse, lui et ses semblables, vers une forme d’errance, de cabinet en cabinet,
menant à l’hyper onsultation. « Ils demandent des tas d’examens
complémentaires », explique Philippe Houdart, généraliste à Paris, qui
s’inquiète moins des cas de la forme grave de la maladie que de « tous ces gens
borderline, à deux doigts de le devenir ». Car le phénomène est en train de
se généraliser. La plus vieille maladie du monde, identifiée depuis l’Antiquité
grecque, considérée par Freud comme « la troisième névrose actuelle », classée
aujourd’hui « trouble de nature anxieuse », selon le DSM, ouvrage
américain de référence sur les troubles mentaux, est en passe de devenir le mal
du siècle. Ce qu’une étude TNS, réalisée en 2012, ne dément pas en indiquant
que 30 % des actes médicaux pratiqués ne sont pas « pleinement justifiés ».
Plus d’un acte sur quatre pour « rassurer les patients », précise le
docteur Houdart.
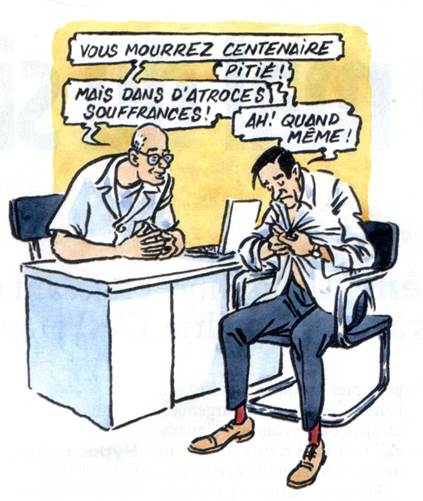
|
|
|||||
Le nouveau mal du siècle
Pour le
professeur Lejoyeux, le bien-nommé, psychiatre à Bichat, auteur de « Réveillez
vos désirs » (à paraître le 27 février chez Plon), ce qui accentue encore plus le
phénomène, ce sont les « névroses médiatiques ». « C’est la société
tout entière qui nous pousse aujourd’hui en permanence vers l’hypocondrie ».
« On ne fait plus un vaccin sans peser le pour et le contre », explique-t-il,
faisant le compte des scandales et des crises de confiance sanitaires à
répétition surexploités par les médias : du bisphénol A aux sulfates, en
passant par le paraben, la mélamine, le Mediator ou les OGM. Pour preuve, le
journaliste Christophe Ruaults, dans son hilarant roman « Confession d’un
hypocondriaque » (1), relève de son côté qu’« entre 1999 et 2006 la rubrique
Santé est passée du 12e au 4e rang du JT ». L’auteur,
à raison, ne parle plus d’« information », mais de « harcèlement ».
Un matraquage médiatique qui a conduit beaucoup des hypocondriaques latents, borderline,
à franchir le cap par le biais, notamment, d’Internet, où prolifèrent les sites
et les forums consacrés à la santé.
Les
cybercondriaques
Aujourd’hui,
sept Français sur dix consultent le Web avant d’aller chez le médecin et
Internet est devenu le deuxième moyen de s’informer, devant le pharmacien.
Conséquence, les psychiatres ne parlent plus pour ceux-là d’hypocondrie, mais
de « cybercondrie ». Des malades compulsifs de l’info médicale, qui passent
leur temps à consulter sur Internet. De Doctissimo à Atoute.org, c’est sur la
Toile que ça se passe. Le forum du site Doctissimo représente la moitié de ses
visites, et le site du docteur Dominique Dupagne, Atoute.org, compte 1 400 000
visiteurs uniques par mois et préfigure le virage vers la télémédecine telle
qu’elle est pratiquée aux États-Unis.Parce que outre-Atlantique les «
cybercondrtiaques » ont une belle longueur d’avance. Abonnée depuis la France
au site américain MedHelp, Audrey, 29 ans, peut poser des questions à des
médecins directement en ligne et obtenir une réponse quasi immédiate. Sur la
page d’accueil, les titres des articles, « Les maladies neurodégénératives de
l’âge : la face obscure de la longévité », « Comprendre la dépendance aux
antalgiques », « Mon bébé souffre probablement de la mucoviscidose », donnent
le ton. Pour circonscrire l’addiction, le site restreint ses cyberpatients à
deux questions par semaine (20 dollars chacune), mais Audrey, dans son besoin
compulsif d’avis médicaux, arrive à « pirater le système », nous
dit-elle, en se créant de nombreux alias. Internet est devenu sa source de
savoir médical en même temps que son médecin traitant. Mais, entre les foires à
l’autodiagnostic des forums et la surabondance d’infos des sites (l’entrée «
Cancer » ouvre 194 millions de pages sur le moteur de recherche Google), Audrey
trouve un apaisement qui se trouve être aussi, et c’est le paradoxe, la source
d’une stimulation perpétuelle de son angoisse.
|
|
Les dangers du Web
Autre menace
dénoncée par les médecins, les « conduites incohérentes » des
hypocondriaques. « Ça peut être un
grand fumeur qui se scrute les orteils », explique le docteur Houdart. Un
danger sur lequel le professeur Lejoyeux insiste : « À cause de leur
grande vulnérabilité, les cybercondriaques s’exposent sur Internet à l’achat de
médicaments miracles et de poudres de perlimpinpin auprès de n’importe quel
charlatan ». Boris Cyrulnik, dans cette même veine, prédit « le
retour aux médecines pittoresques, à la magie, qui peuvent soigner aussi, mais
pas avec les techniques modernes ».
Guérir ?
De l’espoir, on en a à Bichat, puisque aux malades imaginaires on propose des
thérapies bien réelles. Les mêmes que pour l’addiction ou la phobie. Mais 30 %
seulement des patients verront une amélioration persister au-delà de sept mois.Une
amélioration, et non pas une guérison, nous dit-on. Surtout qu’avant d’en
arriver là l’hypocondriaque aura résisté. D’abord à se faire soigner l’esprit,
puisque c’est son corps qui souffre, ensuite parce que, nous dit Lejoyeux, il y
prend du « plaisir » : « Malgré la peur, le malade trouve, même s’il a
du mal à l’avouer, de la volupté. »
Gilles Dupin
de Lacoste, lui, s’en est à peu près sorti. Ce super-hypocondriaque, terrassé
plusieurs fois par jour, pendant des années, par des crises violentes, n’en
connaît plus aujourd’hui qu’une ou deux par an. Son secret au quotidien pour
lutter contre son angoisse : « Dès que j’ai une crise, je prends un
anxiolytique et celui-ci calme la crise, donc je constate que c’est une crise
d’angoisse, et non pas une maladie grave. »Dans son livre paru chez Payot
(2), il prétend même être un « hypocondriaque heureux ». Lorsqu’on
l’interroge, il met toutefois un bémol : « Je ne suis pas heureux au
sens où on entend le bonheur. Mais j’ai compris que mon anxiété s ‘exprime
par l’hypocondrie, et je l’ai accepté. »
Pour les
autres, ceux qui n’ont pas encore trouvé la voie de la guérison, quelle est la
marche à suivre ? « Très bonne question », répond le professeur
Lejoyeux. En attendant des réponses concrètes du côté de la santé publique,
l’hypocondrie, qui n’a décidément rien d’« imaginaire », bat des records ■
1. Michalon, 256 pages, 17 euros.
2. « L’hypocondriaque », de Gilles Dupin de Lacoste
(Payot, 2006).
|
|
|
|
|
|
« Malgré la peur,
l’hypocondriaque trouve, même s’il a du mal à l’avouer, de la volupté. » Pr Michel Lejoyeux |
Comment savoir si l’on est
|
Qui ? Contrairement aux idées reçues, la moitié des
hypocondriaques sont des femmes. Un ratio hommes/femmes stable, avec une
augmentation du nombre ou de la gravité avec l’âge, due à l’approche ou la
peur de la mort. |
|
Quoi ? L’hypercondrie répond à trois critères principaux.
D’abord la préoccupation excessive du fonctionnement du corps, ensuite la
crainte ou la certitude d’être atteint d’une maladie grave, enfin, la
résistance à la réassurance médicale. Parmi les comportements types, le
besoin de porter |
|
soi-même un
diagnostic, le besoin de vérifier celui du médecin, celui de consommer des
médicaments, de multiplier les examens ou les consultations, d’interroger les
proches dans l’espoir d’être rassuré, l’impression de n’être pas compris, pas
écouté, etc. |
|
Quand ? Au sens
psychiatrique strict, la crise doit durer au moins six mois. |
|
Comment ? La plupart des hypocondriaques sont
des hy- per consultants. Mais
ceux qui,à l’inverse, s’angoissent mais ne consultent jamais sont peut-être
atteints de nosophobie, c’est-à-dire la peur d’être frappés d’une maladie. Ce
qui dis |
|
tingue la nosophobie de
l’hy- pocondrie (souvent
mêlées) : le nosophobe craint
d’attraper une maladie (évite les
person- nes qui éternuent, se
lave les mains fréquemment),
l’hypo- condriaque est persuadé
d’avoir déjà contracté la maladie. |
Cyrulnik :
« Désormais, la souffrance est moins physique que psychique »