Sections
du site en Octobre 2009 : Ajouts successifs
d’articles -- Sujets d’articles à traiter – Pour publier -- Post-Polio --
L'aide à domicile -- Internet et Handicap -- Informatique jusqu’à 100 ans
– Etre en lien -- L’animal de compagnie -- Histoires de vie
-- Donner sens à sa
vie – A 85 ans aller de l’avant -- Tous chercheurs -- Liens –Le webmestre.
RETOUR
A LA PAGE D’ACCUEIL : CLIC AUTEURS,
TITRES DE TOUS ARTICLES : CLIC SYNTHESE GENERALE: CLIC
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Octobre 2013
LES
NOUVELLES VIES D’HOMO NUMERICUS
Julie CLARINI
Le Monde ,
Dimanche 25- Lundi 26 août 2013-09-09
Internet est une immense caverne d’Ali Baba où
chacun peut piocher à sa convenance.
Quitte à avoir du mal à s’y retrouver dans ce dédale de connaissances
|
|
La conversation s’interrompt. Charlotte, qui ne
manque pourtant pas d’éducation,
est à sa nouvelle tâche, le regard plongé sur l’écran de son téléphone :
elle cherche un nom qui lui échappe. C’est plus fort qu’elle. « Savoir que l’information est là et ne pas
aller la chercher, c’est impossible pour moi », explique cette trentenaire
webmaster.
Scène de la
vie ordinaire en l’an 2013 :
« Depuis
l’arrivée des smartphones, confirme
Thibault, étudiant dans une école de commerce de Marseille, mon cerveau s’est divisé en deux
parties : ma tête et mon iPhone. Désormais, l’iPhone m’évite de devoir chercher dans ma mémoire et mes souvenirs.C’est comme si nous étions sous perfusion
intellectuelle. Si on débranche, c’est la mort cérébrale. » Belle image,
qui fera pâlir certains mais réjouira sans doute Michel Serres.
Le philosophe va même plus loin : avec les ordinateurs, nous avons
aujourd’hui nos têtes devant nous, tel saint Denis, voire, avec des téléphones,
des cerveaux dans nos poches, jamais fatigués, et surtout toujours
incroyablement savants.
|
------------------------------------------- «
C’est comme si nous
étions sous perfusion intellectuelle. Si
on débranche, c’est
la mort cérébrale » Thibault étudiant -------------------------------------------- |
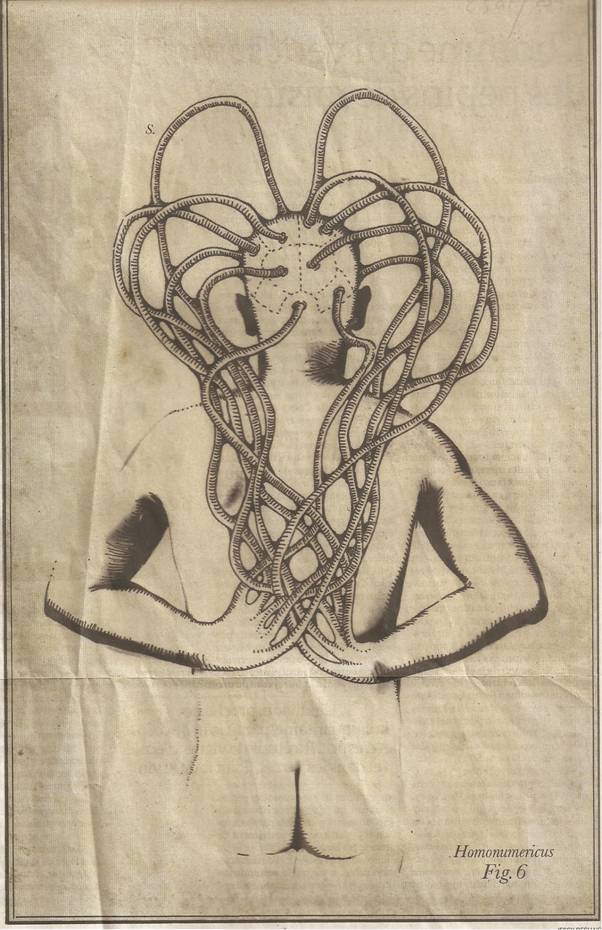
« À mes débuts, la quantité
d’informations me faisait tourner la tête : vite enregistrer, imprimer,
classer, ils auraient pu m’embaucher à la BNF ! s’exclame
Anne-Laure, 22 ans, étudiante en master d’information-communication à Metz. Depuis,
j’ai grandi, aujourd’hui je veille, je classe mes pages favorites, j’apprends,
j’apprends ! » Un enthousiasme largement partagé, et que l’on
comprend : des tutoriels, ces séquences qui vous proposent en vidéos, de
démonter votre tablette ou de vous perfectionner sur les acides aminés, aux
MOOC, « cours en ligne ouverts et massifs », des ressources éducatives mises
à disposition notamment par les universités américaines (les grandes écoles
françaises commencent tout juste), les enseignements les plus divers cohabitent
sur le Web.
On ne souligne plus l’énorme succès
de Wikipédia,
encyclopédie participative et gratuite. Cette envie de partage et
d’apprentissage, c’est simplement l’esprit du Web,diront certains. Et il perdure, même si les usages
récréatifs se sont multipliés.
Quentin, 26 ans, qui a répondu à l’appel à témoignages du Monde.fr, s’est amusé
avec un ami à personnifier la
Toile : « C’est une personne au savoir infini, sa mémoire s’assoit
confortablement sur l’histoire du monde, ses cultures, ses innovations,ses questionnements… Pourtant, malgré cette
richesse, elle passe son temps à faire des blagues de cul et à raconter des
histoires de chats sur des skateboards. »
Plutôt qu’une bibliothèque où
s’étalerait le savoir sur les rayonnages bien ordonnés, Internet est en effet,
d’abord, un grand bazar. Ou plutôt une caverne d’Ali Baba, qui demande un
sésame. En France, il s’appelle Google
– entre 91 % et 93 % des internautes l’utilisent comme moteur de recherche. De
la firme dépendent l’ordonnancement et le classement des informations. Peu
d’utilisateurs d’Internet sont aussi aguerris qu’Anne-Laure, qui, à défaut de
devenir archiviste à la BNF, pousse la passion de l’enquête jusqu’à croiser les
moteurs de recherche. En outre, l’immense majorité se contente des deux
premières pages de résultats, au grand dam du sociologue Gérald Bronner qui, dans La Démocratie des crédules (PUF, 360p., 19€), fustige les fausses croyances induites par la
Toile. Si vous entrez « astrologie » dans votre moteur de recherche, fait-il
remarquer, les premiers sites qui s’afficheront seront quasiment tous
favorables à cette pseudo-science. Internet amplifie,
selon lui, les tendances obscurantistes ou complotistes
en offrant un savoir non trié et non légitimé par les pairs.
Alors, de cette immense échoppe où
chacun peut faire son marché, il ne faudrait pas se réjouir ? « Il y a
un art de la recherche sur Internet. Et c’est comme dans la vie, c’est celui
qui pose la bonne question qui aura la bonne réponse », rappelle sagement
Christian, un magistrat retraité, passionné par l’outil Wiki – la possibilité
de modifier et d’augmenter les pages d’un site – au point que son Grand
Larousse encyclopédique dort maintenant sur l’étagère.
Il revient alors à chacun de mettre
au point ses critères et de peaufiner ses stratégies. Victor, journaliste de 33
ans, explique accorder crédit aux sites de médias traditionnels, comme celui du
Monde, mais ne faire confiance à un blog qu’après avoir dûment regardé
l’onglet « à propos de l’auteur » ; enfin, il dit être toujours très
attentif aux propriétaires
des sites : « Je vais voir sur Wikipédia si
le groupe vit de la publicité ou pas. »
Autres lanternes pour ne pas se perdre dans le foisonnement d’Internet :
les réseaux sociaux. Ils permettent de suivre des créateurs de contenus
(journalistes, universitaires ou artistes) que l’on tient pour fiables. À Facebook ou Twitter, Victor
préfère Seenthis,
où l’on peut conserver des archives.
Et les plus jeunes, comment se
débrouillent-ils dans cet enchevêtrement ?
Pas si crédules que ça, comme le montrent les techniques de validation retenues
par Tamara, lycéenne de 15 ans : « Pour savoir si je peux utiliser un
site comme source, je fais attention aux fautes d’orthographe. Je regarde aussi
les commentaires et l’adresse URL. »
On y revient : ce qui compte,
c’est la porte d’entrée. Internet serait un formidable outil de connaissance… à
condition d’en posséder les clés… « Pas si simple, répond Loys Bonod, en affirmant cela,
on confond consulter et savoir : c’est un terrible amalgame. » Ce prof
de lettres de 38 ans, auteur d’un blog, Laviemoderne.net, tempère l’optimisme
ambiant :
« Le savoir procède de l’assimilation de connaissances. Or, le risque est
que la disponibilité presque immédiate (en apparence du moins) des connaissances
en ligne s’oppose à la patiente et lente construction d’un savoir personnel.
Les élèves sont facilement prisonniers de cette idée, “je google
donc je sais”. Lui-même très versé dans les nouvelles technologies, il a
mis ses élèves à l’épreuve ; il a fait circuler un (faux) corrigé (avec
fautes d’orthographe discrètes) d’un commentaire d’une poésie baroque
(www.laviemoderne.net/malices/9-comment-j-ai-pourri-le-web
) puis a créé une (fausse) entrée Wikipédia au nom de
l’auteur. Résultat ? « Mes élèves [51 sur 65 dans les classes
de première] se sont rués dessus, ils ont fait des copier-coller, plus ou
moins discrets.
Ils ont renoncé à comprendre ! » Internet contre l’effort ? Les
copier-coller sont la hantise des universités, qui se sont dotées de logiciels
appropriés : les mémoires universitaires sont maintenant passés au crible.
Et Tamara, comment fait-elle quand
elle a un exposé à rendre ? Elle va d’abord sur Internet. Puis au CDI, «
parce que là on est sûr des informations que l’on trouve ».
Du piège que Loys Bonod a
tendu à ses élèves, a-t-elle entendu parler ? « Oui, c’est mon père qui
m’a fait lire l’article. » Et où l’a-t-il trouvé ? Sur Internet, bien
sûr… ■
Fin
« Les nouvelles technologies seules ne suffisent pas »
François Taddei est directeur du Centre de recherches
interdisciplinaires.
۩ Les études de l’OCDE montrent qu’un
enfant qui a accès aux nouvelles technologies réussit mieux à l’école. Mais cet
effet est d’autant plus fort que l’enfant vit dans un environnement où il y a
des livres. Ce qui signifie que les nouvelles technologies seules ne suffisent
pas.
Dans une maison où il y a beaucoup de livres,
l’enfant visualise l’écosystème des connaissances : il voit que certains
livres s’adressent à lui, qu’il existe des collections, destinées aux petits ou
aux grands, des livres monographiques, d’autres encyclopédiques,
des ouvrages sérieux et d’autres moins… Bref, il sait qu’il existe des supports
différents pour des connaissances différentes. Il peut ensuite mettre en
pratique cet acquis sur Internet : certains sites lui seront utiles,
d’autres non.
L’école devrait être capable
aujourd’hui d’enseigner aux enfants à “se connaître
eux-mêmes”, comme le recommandait Platon. Se
connaître soi-même, cela inclut savoir ce qu’on sait et ce qu’on veut savoir,
savoir relier les savoirs à son histoire et entre eux.
C’est un préalable essentiel qui évite de tomber dans les pièges, qui surtout
atténue les effets d’intimidation de cette somme de savoirs à disposition.
La grande différence avec les
enfants de la révolution numérique, c’est qu’ils
sont en train d’acquérir le réflexe de la co-construction.
Une petite fille qui n’est pas satisfaite de l’article sur les baleines dans Vikidia, le “Wikipédia enfants”,
va naturellement vouloir l’enrichir, avec cet enthousiasme encyclopédique qui
caractérise les plus jeunes. C’est à nous de comprendre qu’ils ne vivent plus dans un monde aussi hiérarchisé que le nôtre :
Internet fait primer l’horizontalité sur la verticalité, la diversité des
points de vue sur la définition univoque.
La connaissance se définissait jusqu’à présent par les deux étapes de l’acquisition et de la transmission. Aujourd’hui, la co-construction en devient le troisième pilier. » ■
RECUEILLIS PAR J .CL.
Envie
Chercher donne envie de chercher. |
|
Collaboration 591 millions de personnes, dont |
Champions du
monde
Facebook
est aujourd’hui disponible dans 70 langues. Les internautes français ont été
les plus rapides au monde – ils n’ont mis que vingt-quatre-heures – pour
traduire |