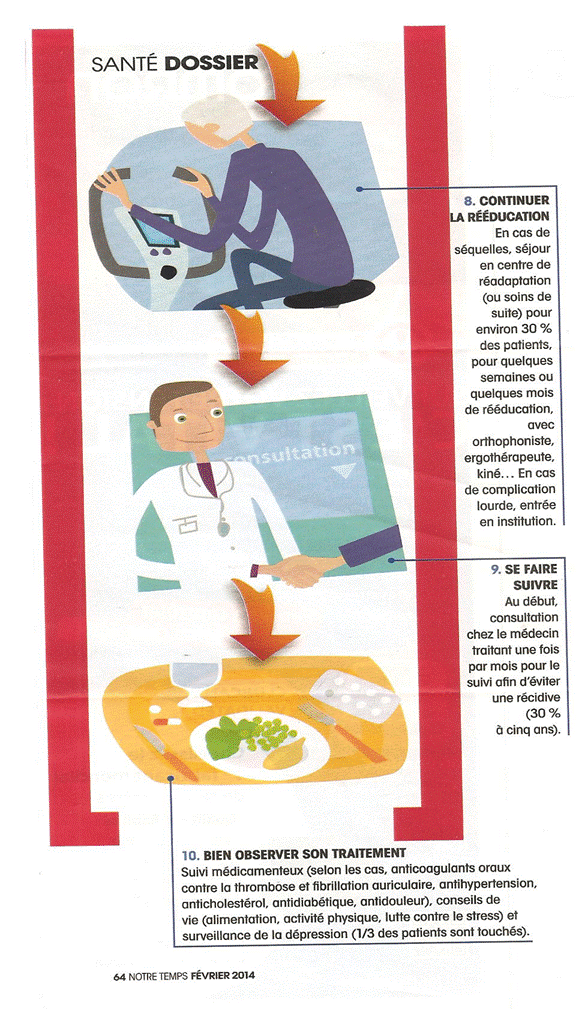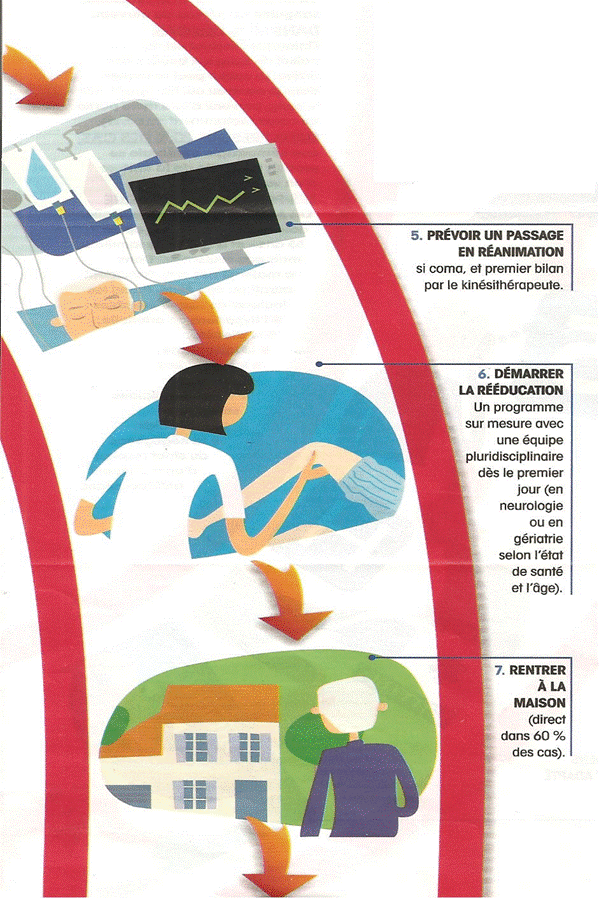Sections du site en Octobre 2009 :
Ajouts successifs d’articles -- Sujets d’articles à traiter – Pour
publier -- Post-Polio -- L'aide à domicile -- Internet et Handicap
-- Informatique jusqu’à 100 ans – Etre en lien -- L’animal de compagnie
-- Histoires de vie --
Donner sens à sa vie – A 85 ans aller de l’avant -- Tous
chercheurs -- Liens –Le webmestre.
RETOUR A LA PAGE D’ACCUEIL : CLIC AUTEURS, TITRES DE TOUS ARTICLES : CLIC SYNTHESE GENERALE: CLIC
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Avril 2014
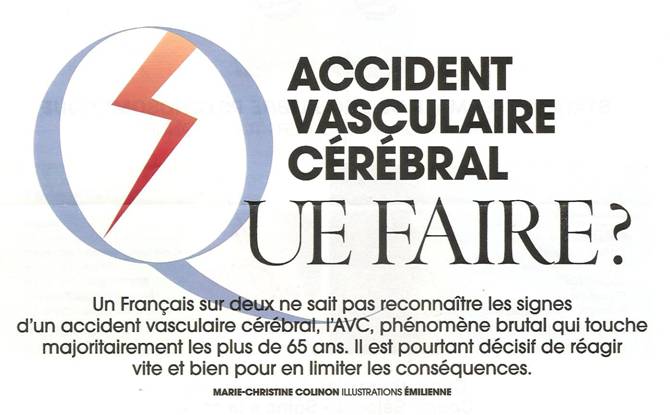
|
A |
poplexie, congestion, attaque cérébrale, accident
vasculaire cérébral : quatre termes pour désigner un accident de santé qui
touche 150 000 Français chaque année, un toutes les quatre minutes. Pourtant,
une enquête Ipsos/Boehringer Ingelheim
(octobre 2013) indique que moins d'un Français sur deux sait en repérer les
premiers signes d'alerte, et 31 % ignorent qu'il faut composer le 15 de
toute urgence. Pour limiter la gravité et les effets secondaires de l'accident,
rejoindre sans tarderun service spécialisé est en
effet déterminant. La prise en charge de l'AVC, en urgence et au fil de la
rééducation, a beaucoup progressé ces dernières années, autant en
bénéficier !
|
Q |
quatre
heures trente pour agir
|
L |
'AVC est un arrêt brutal de la circulation sanguine
au niveau du cerveau, en raison soit d'un caillot, soit d'une hémorragie. Les
premières heures suivant sa survenue sont donc capitales : à chaque minute
perdue, quatre millions de neurones sont détruits par manque d'oxygène.
Rétablir au plus vite la circulation s'avère déterminant pour limiter les
lésions et leurs séquelles. « Jusqu'à quatre heures trente après les premiers
symptômes, le patient doit être dirigé vers une unité neurovasculaire
pour bénéficier d'une thrombolyse », explique le Dr France Woimant, neurologue vasculaire à l'hôpital Lariboisière, à Paris,et chargée de mission sur
les AVC à l'Agence régionale de santé d'Île-de-France.
|
L |
e traitement appliqué aux victimes d’infarctus
cérébral (thrombolyse ou fibrinolyse) consiste à injecter en intraveineuse des
molécules qui vont dissoudre le caillot. Si ce n'est pas suffisant, les
neurologues peuvent délivrer le même produit directement au contactdu
caillot (thrombolyse intra-artérielle), en passant un microcathéter
à partir de l'aine.Il faut parfois jusqu'à une heure
pour atteindre la zone, c'est pourquoi il est possible,et plus efficace, de combiner les deux approches, le
cathéter « finissant » localement le travail et pouvant capturer et extraire ce
qui reste du caillot. Avant d'entreprendrece
traitement, l'équipe médicale s'assure que l'AVC est bien d'origine ischémique (étape
4) et non hémorragique. Un scanner réalisé en urgence différencie les deux
formes. Souvent, une IRM vient en préciser l'étendue. Face à une hémorragie cérébrale,
les médecins sont plus démunis. Le Dr Woimant
reconnaît : « Nous agissons surtout sur les symptômes pour éviter que la
situation ne s'aggrave. Dans de très rares cas, une opération peut être envisagée pour stopper l'hémorragie ou
évacuer du sang. »
|
U |
ne prise en charge capitale
La prise en charge en unité spécialisée offre un réel gain de chances aux patients. Un travail mené par des neurologues dijonnais montre qu'une bonne orientation des malades fait baisser la mortalité de 18 % à 8,3 %. Le plan gouvernemental AVC 2010-2014 avait pour ambition la création de 140 unités neurovasculaires dansles hôpitaux. 120 sont déjà en place. « Or, seul un patient sur deux y a accès, car ces unités sont souvent trop petites et manquent de lits, regrette le Dr Woimant. En attendant d'en augmenter la taille, nous formons les services d'urgence et nous recourons à la télémédecine. »
|
U |
n tel système a ainsi été mis en place fin 2012 entre le CHU de Toulouse et le centre hospitalier Comminges-Pyrénées de Saint-Gaudens (Haute-Garonne), qui ne dispose ni d'une unité spécialisée, ni même d'un neurologue à temps plein. Grâce àla téléconsultation, le neurologue de Toulouse peut visionner les images d'examen du patient à distance, et même guider la thrombolyse réalisée par l'urgentiste deSaint-Gaudens. Une fois traité en urgence, le malade est ensuite transféré dans une unité neurovasculaire pour bénéficier d'une prise en charge pluridisciplinaire. Une deuxièmemi-temps, tout aussi importante, commence effectivement.
|
|
Rééduquer dès le premier jour
|
L |
es séquelles, plus ou moins importantes selon
l'étendue de l'accident et la rapidité de la prise en charge initiale, sont
courantes. Cinq personnes sur huit auront besoin de rééducation pour récupérer.
Selon la zone du cerveau touchée, il pourra s'agir d'une hémiplégie, d'un
trouble de l'équilibre, de la vue, de la déglutition, du langage ou encore de
la mémoire. La qualité de la rééducation mise en place est alors décisive.« Le kinésithérapeute rencontre le patient dès le premier
jour, même s'il est dans le coma. Il dresse un premier bilan et met au point un
programme adapté, en liaison avec es différents intervenants de l'équipe
médicale, explique Éric Delezie, référent national de
l'Ordre des kinésithérapeutes pour la neurologie. « La rééducation est d'autant
plus efficace qu'elle est démarrée tôt », insiste Alexandrine Saint-Cast, psychomotricienne.
Kinésithérapeute, ergothérapeute, orthophoniste, psychomotricien, tous les
intervenants visent le même but : maintenir les circuits de neurones
survivants et stimuler le cerveau pour lui permettre de se réorganiser et de
compenser les pertes. Le travail avec le kinésithérapeute améliore l'équilibre,
la force musculaire, la coordination. L'ergothérapeute aide à réapprendre les
gestes du quotidien (toilette, vaisselle, préparation des repas...). l' orthophoniste intervient en cas de troubles du langage,
de la déglutition,de l'orientation dans l'espace. Au
besoin, un orthoptiste et un psychologue pourront être sollicités. Après
environ dix jours de rééducation intensive à l'hôpital, le programme se
poursuit en centre (jusqu'à quatre heures par jour) ou à domicile.
Une récupération au fil des mois
|
« |
La récupération, souvent spectaculaire durant les trois à six premiers mois, est progressive et prend parfois des années, encourage Éric Delezie. Et c'est vrai aussi chez les patients plus âgés. » Mais les places en centre de soins de suite sont trop peu nombreuses et il arrive que les patients les plus âgés, hélas, sont moins facilement orientés vers ces établissements. Ce sont alors les kinésithérapeutes de ville qui prennent le relais, généralement à raison d'une séance d'une demi-heure tous les deux jours au minimum.Ces séances sont l'occasion de guider l'entourage pour aider à poursuivre la récupération au fil de la vie quotidienne, par des exercices à pratiquer aussi longtemps que le bilan de réévaluation, effectué au bout d'environ six mois, le préconise.
|
« |
Si
le médecin généraliste ne prescrit plus de rééducation, alors que la vie
quotidienne reste difficile, il faut reprendre rendez-vous avec l'unité neuro-vasculaire ou avec un gériatre », estime Éric Delezie. « Les
patients ne prennent pas toujours leur maladie en main, ainsi 12 %
ignorent si leur AVC est dû à un infarctus ou à une hémorragie, pointe le Dr
Woimant. Or, il est primordial de le demander avant
de quitter l'hôpital, notamment parce qu'en cas d'hémorragie, aspirine et
anticoagulants sont proscrits. »
|
L |
|
@ |
COMPRENDRE L'AVC EN VIDÉO |
| sur notretemps.com/santé Rubrique Vidéos |
es
succès s'engrangent à force de persévérance, au prix d'un entraînement sans
relâche, que certains n'ont pas l'énergie ou la motivation de pratiquer,
souvent parce qu'ils souffrent d'une dépression mal −
ou pas du tout −
soignée. n
|
|
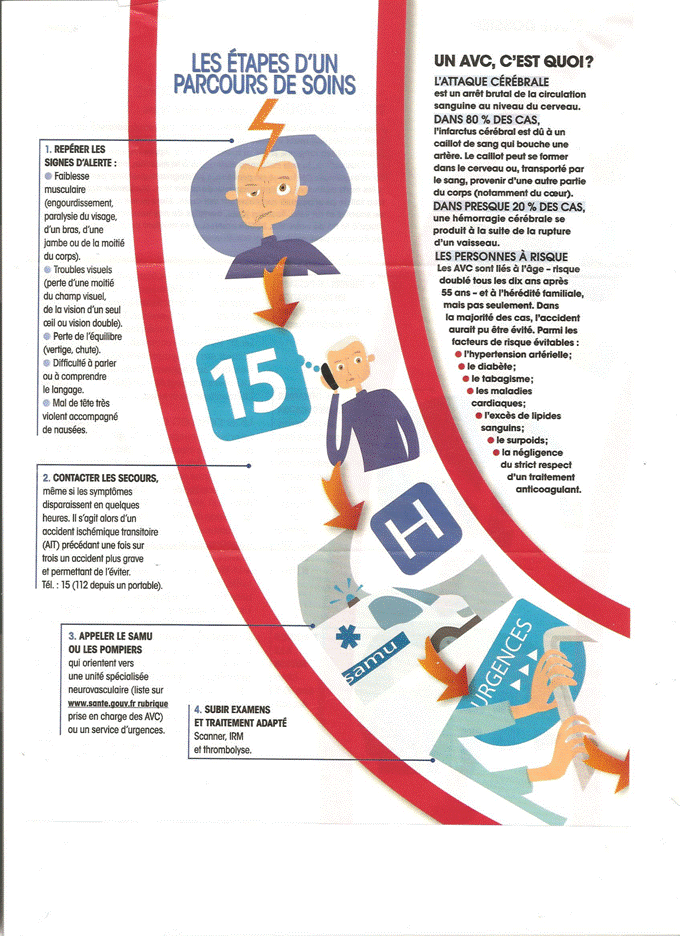
|
|
|
« DES PROGRÈS, J'EN FAIS ENCORE TOUS LES JOURS »
JEAN-MARIE PÉREZ,
70 ANS « Après un infarctus cérébral en 2004, je me suis retrouvé paralysé du côté droit,
totalement muet et avec des problèmes de déglutition. Avant, je parlais cinq
langues, je les ai toutes perdues. Après un mois en centre de rééducation, je
suis redevenu autonome à la marche, capable de m'exprimer : j'ai trouvé
un processus photographique pour parler, comme si les mots défilaient sur un
prompteur dans ma tête. Ma jambe droite reste trop faible pour remonter sur
ma moto. Alors je me suis mis au scooter et au vélo. Tous les jours, certains
de nos neurones meurent mais, jusqu'à la fin de notre vie, 30 000 nouveaux se
mettent en place et il faut |
|
MARIE DE HENNEZEL, PSYCHOLOGUE : « NOS PROCHES ÂGÉS ONT PARTICULIÈREMENT BESOIN D'ÊTRE ENTOURÉS » « Après un AVC, les personnes les plus âgées n'ont
pas toujours la force de se battre pour remonter la pente. L'entourage est
d'autant plus important. Se sentir aimé revitalise. Il faut dire au malade
que nous croyons en sa capacité de récupérer. Mais aussi que, même s'il ne
récupère pas entièrement, sa vie compte pour nous. Voilà l'essentiel. Si la
victime d'une AVC peine à parler, il faut mettre des paroles sur l'état
d'esprit que nous devinons, essayer de verbaliser ce qu'elle éprouve : |